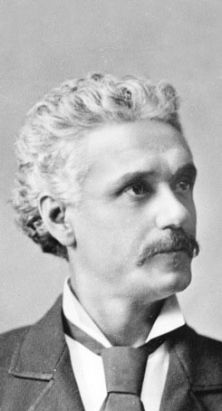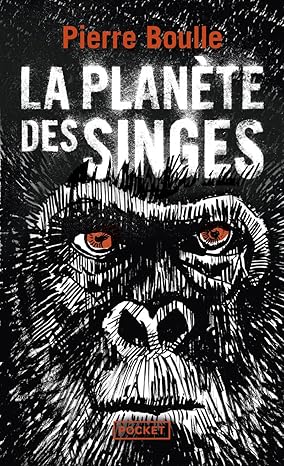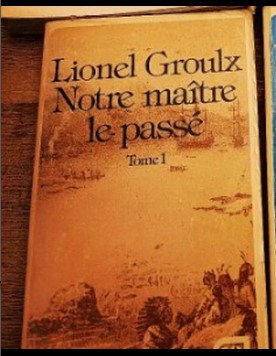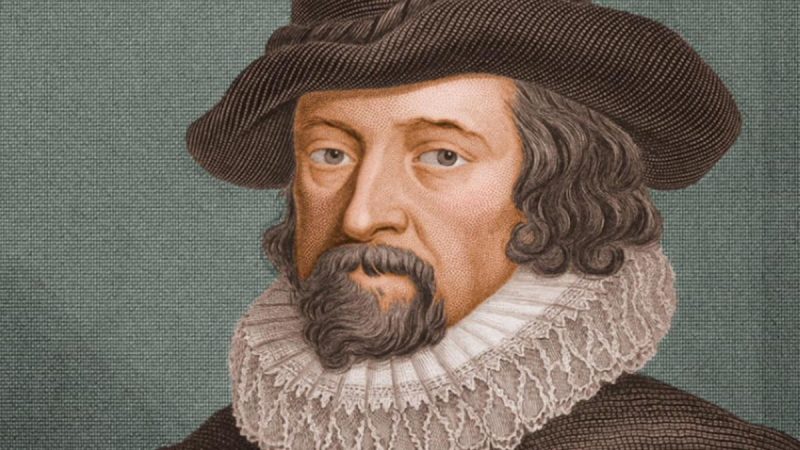À la ramasse jusque-là, l’aventure politique de Justin Trudeau a véritablement pris son envol en 2015 lorsque son parti dévoila un programme électoral nettement socialiste et mondialiste. Le Parti libéral du Canada, jadis ignoré voire méprisé par les médias traditionnels et les artistes, venait de frapper un grand coup. La relation fraternelle entre la sphère politique, le milieu artistique et les journalistes allait progresser à la vitesse de l’éclair – une corruption intellectuelle digne des pires régimes bananiers. Un interventionnisme étatique décomplexé qui allait provoquer une orgie de déficits, de subventions et d’avantages à des médias et à des artistes maintenant reconnaissants et soumis aux diktats gouvernementaux.
Les artistes ont un impact considérable sur la population. Sur le plan culturel, évidemment, puisqu’une nation se définit d’abord par sa richesse culturelle, mais également sur le plan idéologique et politique. Ils sont les outils propagandistes par excellence d’une gauche radicale qui cherche à légitimer son programme à tendance orwellienne. Le degré d’influence d’un artiste dépendra immanquablement de son niveau de popularité. Le pouvoir d’attraction d’un Guy A. Lepage, bobo montréalais classique, dépasse largement celui d’un musicien amateur ou d’un acteur médiocre. Le citoyen moyen est désabusé et s’intéresse peu à la politique, que ce soit par indifférence, manque de temps ou écœurement. Les taux anémiques de participation des dernières élections n’illustrent-ils pas un raz-de-bol populaire ? Les politiciens, et particulièrement les députés, constamment conspués et mal-aimés, classés parmi les professions les plus surestimées et les moins admirées, ont atteint les bas-fonds de la médiocrité lors de la crise covidienne ; leur insignifiance, leur état pusillanime et leur nullité n’étonnant plus personne et en choquèrent plus d’un ; ils furent une insulte à notre intelligence. Le citoyen s’intéressera davantage aux sports, à la météo, aux dernières tendances technologiques, aux potins artistiques, à la cuisine, aux séries télévisées, au cinéma – la culture populaire en quelque sorte. C’est la netflixisation occidentale ou la « nation-pyjama ». Les médias traditionnels et les artistes, tous deux interreliés par une proximité naturelle tant leurs protagonistes pataugent dans les mêmes cercles intellectuels et publics, correspondent, par leur caractère récréatif et éducatif, des composantes prééminentes de notre vie sociale. Ils peuvent susciter le débat, éveiller les consciences, raconter notre quotidien, nous émouvoir.
La montée de la gauche radicale et de sa torture psychologique
Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la civilisation occidentale ne cesse de chanter les louanges du mondialisme, du métissage, de l’inclusion. Nous vivons à une époque aseptisée qui voit des drapeaux naguère rassembleurs et synonymes de fierté et d’honneur – la fleur de lys québécoise, le tricolore bas-canadien, l’étendard sudiste des États conférés d’Amérique, les étoiles et les bandes états-uniennes etc. – répudiés par le temple de la renommée de l’horreur gauchiste. Avec la crise des camionneurs de février 2022, même l’Unifolié canadien devint un paria à travers la lunette de médias totalement disjonctés.
Une gauche radicale se leva et atteignit un tel degré de nuisance qu’elle incarne à ce jour une parodie d’elle-même, elle qui s’aromatise au parfum du communisme soviétique ou chinois. Certains en rient, mais son bataillon woke mène sans pudeur une guerre culturelle acharnée qui malgré des apparences rigolotes est bien réelle. Une gauche qui cherche à éliminer le moindre symbole identitaire pour venir ensuite y implanter un État mondial dit supranational. Elle espère, bref, imposer son autorité. Elle a spolié l’esprit critique du journalisme et le patriotisme de l’artiste pour en faire ses joujoux, ses marionnettes, ses idiots utiles. On se rappellera de l’aura identitaire, de l’amour pour la terre natale de ces chansonniers, paroliers, musiciens, cinéastes, comédiens, dramaturges, peintres et écrivains qui de leurs doigts, de leur voix, de leur âme, chantaient, dessinaient, racontaient ou turlutaient avec une passion émouvante l’épopée canadienne-française, le retour à la terre, les joies et les peines de nos bâtisseurs, la beauté de nos lacs, de nos forêts, de nos villages, de nos quartiers. Les vers de nos poètes héritiers de la Nouvelle-France, les contes de Le May, les pamphlets enflammés de Buies, la prose de Saint-Denys Garneau, l’appel à la race de Groulx, les rigodons de nos grands-pères, les légendes de nos raconteurs, les mélodies et la parlure de Beau Dommage, Le plus beau voyage de Gauthier, Le tour de l’île de Félix, les Gens du pays de Vigneault. Mais tranquillement fondent, comme neige au soleil, ses traces de nous-mêmes, ébranlées par la méchanceté et l’infidélité de ces gens attirés par une idéologie aux allures maléfiques. Si je rejette l’idée que notre monde se résume à un prisme manichéen, nous assistons néanmoins à la présence d’une force maudite qui fait table rase de notre héritage collectif.
Le simple citoyen est laissé à lui-même. Les médias ne sont plus les chiens de garde de la classe moyenne ; ils participent à son oppression. A défaut d’avoir des arguments pour contrer leurs opposants, ils fabriquent des controverses et lancent des étiquettes. Ils utilisent ce que je qualifierais d’un gel paralysant pour déstabiliser, intimider, ostraciser, diaboliser. Une stratégie somme toute courante dans l’histoire humaine, un refrain répétitif qui fut, pour un temps du moins, d’une efficacité chirurgicale : un « raciste » par ici, un « covidiot » par-là, un « extrémiste de droite » comme dessert.
Ceux qui il n’y a pas si longtemps, dans les années 1960, à l’ère où le libéralisme avait encore ses lettres de noblesse, criaient leur désir de vivre librement, offrent à présent un visage autoritaire, signe que cette démocratie qui se voulait libérale dérape moralement. Ceux qui fantasmaient sur l’émergence d’une société progressive éloignée des dogmes catholiques forment aujourd’hui cette caste élitique qui ne supporte pas d’être contredite par qui que ce soit sortant du schéma narratif officiel. En proposant un monde nouveau, ils ont dénaturé ce pourquoi nos ancêtres combattaient, ils ont trahi leurs aïeux, notre passé. Ils expriment une sorte de pensée unique formulée subtilement à une population qui se laissera berner par ce matraquage idéologique kafkaïen. Un biais bien souvent invisible, finement orchestré par une propagande multiservices ; le citoyen captif, submergé de rectitude politique, de mélodrames tiers-mondismes, d’ethnomasochisme, de slogans à la sauce trudeauienne – que la diversité est notre force, qu’il y aurait chez nous la présence d’un supposé racisme systémique ou d’un suprématisme blanc − d’apologies au transgenrisme et à l’immigrationnisme, de prêtres pédophiles, de sans-frontiérisme, de sanitairement correct, autrement dit, c’est la haine de soi, la hantise de la famille traditionnelle, des traditions du catholicisme, de l’homme blanc hétérosexuel, des fondements de la civilisation occidentale hérités de la civilisation gréco-romaine.
La métamorphose de l’artiste
Notre attachement pour le milieu culturel est incontestable. En tant que peuple canadien-français isolé dans une mer anglosaxonne assimilatrice, cette solidarité fraternelle forge notre identité et permet d’être encore là après plus de quatre siècles en sol nord-américain. Mais nos artistes, qui constituent l’un des socles de notre personnalité historique et de notre survivance en tant que peuple fondateur canadien, s’éloignent de leur mission première, celle de participer à l’épanouissement culturel de la race canadienne-française. Non seulement n’y contribuent-ils plus activement, ne laissant que des souvenirs impersonnels qui les accompagneront au tombeau ou ne transmettant que des archives poussiéreuses qui aboutiront dans les limbes de notre histoire, mais rejettent-ils aussi le principe même d’une nation canadienne-française sujette à devenir minoritaire sur son propre sol (nation unique d’essence française et catholique) en l’associant aux pires crapules de l’histoire – esclavagisme, colonialisme, racisme. Leurs réalisations et leurs propos, ornés autrefois d’un nationalisme ethnique bien enraciné, se sont transformés en répliques du monstre hollywoodien et en militants partisans d’un mouvement mondialiste impitoyable, prétextant un idéal gnangnan où les licornes fredonnent du John Lennon, négligeant la langue française par la multiplication d’anglicismes et de franglais, délaissant la langue française pour se tourner vers une langue plus universelle, le globish anglais, applaudissant lorsqu’une église tombe sous le pic de démolisseurs ou de mercenaires gauchistes. D’atouts à la cause canadienne-française, ils devinrent de vulgaires jouets capitalistes sans âme. Leur manque de sensibilité nationaliste se sent comme jamais. Ils personnifiaient l’espoir, le catalyseur indépendantiste, le « nous ». Ils nous tendaient le flambeau bien haut. En 2022, ils fonctionnent à l’américaine, sans originalité avec une opérette de thèmes opposés au nationalisme et ne prônant qu’une option politique, celle d’une gauche cosmopolite écolochamaniste. Pour les réfuter, la droite identitaire a comme seul instrument de communication les médias alternatifs. Une guerre culturelle est nécessaire afin de faire contrepoids à ceux qui plaident pour le mondialisme, l’écologisme radical et un étatisme illimité ; à ceux qui rêvent d’inclusion et de diversité à tout prix ; à ceux qui réécrivent l’histoire dans un révisionnisme qui va du déboulonnement de statues à des séances d’autodafé et de censure. L’exercice du réel dépasse parfois les univers des meilleurs romans d’anticipation.

Le Refus global fût le précurseur d’un Québec qui allait peu à peu tourner le dos au catholicisme et appuyer sur l’accélérateur progressiste. Cette société laïcarde devenait l’excuse parfaite pour abandonner cette religion qui de l’avis de plusieurs, freinait, à tort, notre émancipation et notre développement collectif – qui de leur avis ne pouvait qu’être à gauche. Le Parti Québécois qui, à ses débuts, coalisait les différents courants politiques souverainistes, et qui était porté par l’enthousiasme des Deschamps, Ferland, Julien, Leclerc, Léveillé, Lussier, Piché, Vigneault, montre dorénavant un corps agonisant atteint d’un cosmopolitisme gauchiste quasi incurable ; miroir de cette gauche indépendantiste qui saborde le nationalisme identitaire et qui renie ses principes d’unification politique derrière une idée, celle de créer en Amérique un État de gauche parlant français, un Cuba du nord. Cet État, ces tenants de la vérité – la leur – le veulent à condition qu’il soit de gauche ou socialiste. Comme le pense Québec solidaire. L’appétit pour un Québec indépendant coûte que coûte devient alors un fourre-tout gauchiste débilitant. C’est une gauche dopée par le pouvoir qui appuie sans réserve un modèle québécois pourtant en pleine débâcle. Le chaos hospitalier covidien est là pour le rappeler.
Nous avons devant nous un mouvement souverainiste totalement désorganisé. Il y a la droite identitaire, la seule qui se bat pour la pérennité de la nation canadienne-française et qui a compris l’importance de notre devoir de survivance ; elle s’oppose à une droite économique et patronale pour qui la liberté n’est qu’un ramassis de libertés individuelles et qui appelle constamment à l’immigration de masse pour renflouer sa banque d’employés bon marché, elle qui s’allie, drôle de tandem, à la gauche mondialiste ; de cette gauche ressort la frange souverainiste à la sauce Québec solidaire et péquiste et celle fédéraliste à la sauce libérale. Alors que René Lévesque s’alarmait devant notre noyade migratoire programmée par le gouvernement fédéral, des souverainistes du 21è siècle défendent le multiculturalisme canadien et additionnent les messages immigrationnistes. Ces derniers sont habités d’un intégrisme cosmopolite alarmant pour un peuple qui cherche à reconquérir ses origines. Le milieu artistique patauge dans ce bain gauchiste, tantôt souverainiste, tantôt fédéraliste, mais toujours plus à gauche. Des artistes engagés dans la mauvaise voie.
La droite identitaire est majoritairement souverainiste, il va de soi, mais elle n’est pas suicidaire. Elle reconnait qu’une autre défaite référendaire serait catastrophique. Il s’agit, pour elle, d’opter pour une alternative plus réaliste et optimale, l’étapisme, qui se veut la quête progressive de pouvoirs en calculant qu’au passage des confrontations à la Lac Meech échaufferont les esprits et créeront des conflits irréversibles. C’est choisir la patience. Cette droite ne fait pas partie de ces souverainistes pressés, qui comme des poules pas de tête, pratiquent un faux nationalisme, le nationalisme civique − celui qui parle d’inclusion, de diversité et de racisme systémique, celui qui s’autoflagelle. Le souverainisme de la belle époque, celle des grands espoirs et du « nous » qui se travestit en souverainisme à la solde du mondialisme. Des prétendus nationalistes qui consentent aux changements démographiques que nous subissons. Des artistes, Québécois de souche, autrefois gardiens de la nation canadienne-française, contaminés par le gauchisme et le mondialisme ambiants, qui déracinés, s’amourachent de concepts politiques utopistes ou contraires à nos intérêts nationaux. L’écologisme, passion bon chic bon genre, parfois sincère, souvent hypocrite, sujet à des sermons de petits génies qui aiment les feux de la rampe et qui se drapent de fausses vertus, est un cas symptomatique de cette bouffonnerie politique. Comme ces souverainistes ratés qui veulent faire du Québec le premier pays vert au monde. Rien de moins. Faire l’indépendance pour la cause écologique ou pour nous offrir un Québec sous le joug du socialisme, plaçant la question identitaire aux oubliettes.
Préserver notre faune et notre flore, soigner nos lacs, nos rivières, notre majestueux fleuve, notre terroir : c’est ici une sorte de conservatisme prometteur et légitime pour une nation qui, pour exister, doit se respecter soi-même. Veiller à notre sol laurentien, pierre d’assise de notre nation de découvreurs et de défricheurs. Tout patriote canadien-français adhère, ou doit adhérer, à cette évidence. Mais la nouveauté réside dans l’extrémisme, dans l’écoterrorisme, oserais-je dire. Une certaine gauche, capable de bien des bassesses au nom de la protection de l’environnement, inapte en revanche à travailler à la pérennité de ceux qui vivent sur ce territoire depuis des siècles. Ces soi-disant amoureux de la nature ont avant tout un agenda politique. La chose environnementale ne sert qu’à assouvir leur soif de domination. Ces idéologues propagent la peur et les comparaisons boiteuses en instrumentalisant Mère nature.
La pensée unique
Une pensée unique s’installa d’abord autour du gauchisme, du mondialisme et de l’écologisme, puis tout récemment autour du sanitarisme. Le moindre écart de conduite idéologique est tourné en dérision et pointé du doigt. Des regards moqueurs et arrogants se tourneront vers le climato-septique, le conservateur, le critique des mesures sanitaires, le pessimiste face à notre avenir démographique, le lunatique qui prédirait des complots, l’inquiet de l’insécurité de nos villes qui pullulent de racailles incontrôlables. Un endoctrinement tentaculaire d’une pensée qui compte le milieu artistique parmi ses plus importants acteurs.
« On est dans une ère où, tout à coup, il y a des choses qui ne sont plus acceptables […] La représentation de la diversité culturelle dans le milieu artistique n’est d’ailleurs pas un enjeu nouveau pour l’UDA, qui dit plancher sur la question depuis quelques années déjà, notamment avec des membres issus des minorités. C’est bien dommage, mais la réalité telle qu’on l’a connue – la scène, la télé, le cinéma – ça n’a plus sa place. Ça va devoir changer, s’adapter à notre réelle réalité de Québécois. Ça, pour moi, c’est sain, explique Sophie Prégent.[1]»
Voilà des artistes qui se prennent pour des justiciers sociaux. Ils partent en croisade pour accroître la présence des minorités visibles dans leur industrie et pour implanter des quotas, nouveau dicton multiculturaliste à la mode. Fidèles au courant idéologique qu’ils véhiculent, ils font de la haine de soi leur ritournelle préférée. S’effacer soi-même en s’agenouillant devant des immigrés qui pleurnichent sur un racisme systémique imaginaire. Nous sommes si racistes qu’ils sont pourtant des milliers annuellement à vouloir immigrer chez nous.
Des personnalités publiques qui surutilisent une série de clichés et qui promeuvent la diversité comme étant la recette gagnante au bonheur et à la paix universelle. La réalité est plus complexe. C’est le règne de l’émotion dans une manœuvre de déstabilisation occidentale où l’antiracisme pathologique et l’égalitarisme appellent à notre soumission. Une bien-pensance qui n’est satisfaite que si elle débat avec elle-même. La nouvelle mouture idéologique de l’artiste se dissocie du nationalisme ethnique qu’il professait jadis. Dans un revirement historique sans précédent, il joue un rôle analogue à celui des orangistes et des forces anglaises assimilatrices. La majorité historique québécoise, abandonnée à son propre sort, mériterait une réponse musclée de ses élites face à sa louisianisation. Les artistes qui étalaient leurs biceps devant les attaques ennemies changèrent de camp, obsédés par leur gauchisme mondialiste. Le « péril populiste » doit être éradiqué, ajouteront-ils aussi sans rire. Les citoyens boivent les paroles d’une colonie artistique qui en mène large au Québec. Notre petit village gaulois, isolé par la barrière de la langue et notre culture si unique, a fait de ses artistes ses chouchous, un élément de réconfort, le fer de lance de son identité nationale, ceux vers qui se tourner pour s’émerveiller, se divertir, s’instruire, se consoler. C’est à travers eux qu’un message politique se propage le mieux. La population, qui manifeste un intérêt apathique et mitigé pour la chose politique, sera influencée de manière parfois subliminale par une chanson, une entrevue ou un film à connotation politique. Surtout si l’œuvre s’accompagne d’un barrage publicitaire et d’un blabla politique répétitif diffusé à grande échelle. C’est ici que leurs messages s’engagent dans un processus de persuasion. Le phénomène des « changements climatiques », expression galvaudée et superficielle, cadre avec cette propagande qui verra bien des individus admettent innocemment les dires des lobbys verts ou moraliseurs.
La gauche contemporaine ensorcelle et fait fléchir les politiciens. Le triangle amoureux politico-médiatique-artistique forme un trio redoutable, un rouleau compresseur anarcho-tyrannique qui impose brutalement et somme toute aisément ses dogmes, ne faisant face qu’à un adversaire encore faible, la droite identitaire en pleine reconstruction. Nuancés hier, les médias s’unissent aujourd’hui derrière une devise commune, un consensus idéologique qui dissimule un univers liberticide. Le gouvernement Trudeau incarne ce précédent dangereux, celui de l’autoritarisme libéral qui œuvra arbitrairement pendant la crise covidienne. C’est la gauche qui dérape et qui se radicalise toujours plus. C’est le règne de la laideur et de l’hypocrisie. C’est l’échec de la démocratie. C’est le militantisme idéologique avant la patrie. Ce sont les libertés individuelles seulement si elles s’accordent avec sa doctrine politique. C’est la tolérance pour ceux qui ne dérogent pas de sa rhétorique et de ses croyances. C’est la corruption intellectuelle. C’est le copinage et le patronage. C’est le côté sombre de l’humain.

La censure et l’autocensure deviennent une norme non écrite puisque plusieurs craignent les accusations de raciste ou de xénophobe. Une vague de condamnations d’hérétiques nous plongeant dans l’absurde inquisiteur. Qu’un média affiche ses couleurs idéologiques n’a rien de nouveau. Le 19è siècle québécois a été témoin de centaines de publications qui allèrent du libéralisme à l’ultramontanisme, du rouge libéral au bleu conservateur en passant par des journaux et périodiques catholiques ou anticléricales. Le 21è siècle constitue par contre un tournant dans notre histoire médiatique. À bout de souffle, les médias traditionnels eurent leurs poches renflouées par des gouvernements trop heureux de pouvoir compter sur une Pravda version 2.0. Ces médias subventionnés perdirent le sens du combat populaire et démocratique et se mirent à cumuler les axiomes, les amalgames douteux et les harmonies idéologiques dans un unanimisme qui se refléta dans la crise covidienne, la guerre ukrainienne et dans cette intransigeance vis-à-vis le patriotisme. De la masturbation intellectuelle entre amis. Ce monologue idéologique contraste avec le certain libre-arbitre intellectuel des deux derniers siècles.
Celui qui placera le patriotisme canadien-français au centre de sa vie marchera donc en terrain miné. Défendre son héritage culturel, linguistique et historique est l’essence même de la vie. Raisonner autrement est contre-nature – c’est la résultante d’un bourrage de crâne excessif. Le patriotisme ethnique n’a rien de raciste, ni d’intolérant et est encore moins la démonstration d’une supériorité morale ; ce n’est que l’aboutissement d’une logique intrinsèque ancrée dans l’esprit humain. Depuis toujours l’Homme cherche à se reproduire, à protéger les siens, à perpétrer la mémoire des disparus, à s’assurer que sa famille soit en sécurité. Les artistes sont généralement en diapason avec l’histoire, la culture, la mentalité populaire, les traditions. Notre folklore prend racine de ces artisans, ces créateurs, ces chanteurs et ces rêveurs qui, habités par leur pays et leurs aïeux, racontent le passé, la famille, la beauté du paysage, les mœurs anciennes, nos luttes, nos victoires. Une nation se construit autour du respect accordé à ceux qui gisent dans nos cimetières. Ces artistes qui adoptent le mondialisme comme leitmotiv agissent à contre-courant de la nature humaine. Ils sont menés par une force caractéristique elle aussi de la nature humaine, c’est-à-dire la recherche du pouvoir. C’est ici que se scelle le destin manichéen de l’Humanité.
Notre devoir est d’immortaliser notre race, l’emblème de qui nous sommes. La culture révèle à elle seule bien des secrets et sert de guide aux patriotes les plus sincères. Elle célèbre notre passé et magnifie notre patrimoine : avec ces statues et ces monuments saluant nos bâtisseurs et nos pionniers, ces forts, ces remparts, ces églises, ces cathédrales et ces maisons d’antan qui décorent nos villes et villages. Ces repères historiques forment un contre-poids émouvant à la surenchère mondialiste. Les artistes doivent embarquer dans la danse avec nous, les patriotes canadiens-français, et servir d’inspiration et de rampe de lancement pour un renouveau identitaire dans une guerre culturelle qui s’annonce éreintante. Ils doivent cesser leurs enfantillages mondialistes et les raccourcis intellectuels qui en découlent en laissant leur égo au vestiaire. Ils doivent encourager et non plus fustiger les porteurs de nationalisme à la Bernier, Orban, Trump et Zemmour. Laissons-nous bercer par la nostalgie, par ces hymnes à la patrie, ces vers d’oreille aux rythmes enchanteurs si souvent chantés et appréciés des générations qui passent. La vie ordinaire des hommes et femmes de chez nous racontée par le talent d’ici. Une affirmation nationaliste, pas si lointaine, partie peu à peu avec la mort de Félix, qui sombra doucement avec l’arrivée du nouveau millénaire, dans un malaise identitaire apporté par le défaitisme, le gauchisme, le mondialisme, la superficialité, le capitalisme sauvage, l’image et l’instantanéité. L’artiste s’éloigne de ces années charismatiques qui rimaient avec orgueil national. Ces années qui donnèrent au joual ses ailes, qui refusèrent notre anglicisation et dans lesquelles un simple « Bonjour-Hi » aurait soulevé la colère de plusieurs – formule reprise comme étant un bouclier contre la mauvaise humeur de quelques anglophones pour qui la langue française est de trop dans un continent nord-américain anglosaxon et de plus en plus multiculturel.

Le sens de l’honneur manque à ces artistes québécois qui doivent leur carrière à notre langue et à notre culture. Le mondialisme qu’ils louangent tant amène une rectitude politique qui brime leur liberté artistique, prohibe toute reconnaissance pour le peuple fondateur et déstabilise une société qui se retrouvera tôt ou tard sans noyau commun. Les valeurs et les mœurs de certaines communautés entrent également en collision frontale avec celles de la civilisation occidentale. Ce choc des cultures, grosso modo cette incompatibilité aiguë, avantage un islam politique conquérant qui profite de notre aplaventrisme et de notre mollesse légendaire pour progresser. Le mondialisme (et son multiculturalisme) engendre la ghettoïsation raciale et des tensions entre les communautés ethniques ; mais c’est le mouvement identitaire qui selon quelques langues sales diviserait et accentuerait la violence. La population est victime bien malgré elle d’une double ignorance socratique.
Si les Canadiens français témoignent encore d’un sursaut patriotique quoique nonchalant et en dormance, nos compatriotes canadiens-anglais, eux, s’enfoncent dans un postnationalisme définitif. Ils se font cocufier et ils en redemandent passionnément. Le Convoi de la liberté qui défraya les manchettes et qui regorgeait de drapeaux canadiens n’était qu’un mirage patriotique. Ces gens ne cherchaient, et avec raison, qu’à mettre fin à la dérive liberticide covidienne, à retrouver leurs libertés perdues et leur vie d’antan. D’ailleurs, le Convoi rassemblait une multitude de groupes sociaux et ethniques pour qui la liberté individuelle – religieuse entre autres – est un principe inviolable. Une liberté individuelle doit être remise en question si des intérêts nationaux l’exigent – le contrôle des frontières en est le meilleur exemple, mais non pas les mesures sanitaires puisqu’elles étaient arbitraires et dénuées de débats et de fondements scientifiques valables, elles qui étaient d’abord politiques et électoralistes.
Un déclin identitaire encouragé par nos artistes
Les Canadiens anglais ne seront évidemment d’aucun secours face au déclin identitaire canadien-français, et ce même si le nationalisme coulait à nouveau dans leurs veines. Depuis la Conquête britannique, ils n’espèrent qu’une chose : nous assimiler. Si un Stephen Harper ne détestait pas jouer la carte du patriotisme, il fût, comme bien d’autres avant lui, très modéré dans son approche. Avec lui également le multiculturalisme et l’immigrationnisme continuèrent leur marche pressée ; tout comme son patriotisme, ils étaient au moins teintés d’une certaine retenue et sobriété. Son successeur libéral allait proposer la même recette mais de manière agressive et absolue, sans concession. Les Canadiens-français sont ainsi prisonniers d’un carcan fédéral gauchisant étouffant. Cette gauche canadienne qui mène notre nation au bord du gouffre voit dans notre patriotisme canadien-français un populisme vulgaire, sous-entendant qu’il est paré de racisme, de paternalisme et d’intolérance. Cette condescendance et cette arrogance définissent une gauche mondialiste indifférente au sort d’une classe moyenne fatiguée par un fardeau fiscal écrasant et une immigration massive qui alourdit nos charges sociales et change notre paysage démographique. Un appauvrissement collectif doublé d’une crise du logement rempirée par une immigration maintenant massive. Cette pauvreté attristait il n’y a pas si longtemps des artistes devenus insensibles, sectaires idéologiquement ou tout simplement inaptes à comprendre les répercussions négatives de ses choix politiques. Si une certaine gauche plus terre à terre se veut encore très solidaire du peuple, c’est principalement le mouvement identitaire chez qui prime le sens de l’honneur et de loyauté envers le peuple. Nombreux sont ceux qui joignent ce mouvement comme réponse spontanée aux agissements d’une élite ou d’un État profond inhumain et sans cœur. Une oligarchie ploutocratique se dessine devant nos yeux. Les politiciens se disent tous, dans leurs phrases creuses à saveur électoraliste, à l’écoute des citoyens, mais dans les faits, ils agissent par sondages, par clientélisme, par amitié, par partisanerie, par paresse, par renvoi d’ascenseur au cartel bancaire et pharmaceutique ou par la suite de pressions exercées par un lobbying puissant.

La menace la plus palpable pour nous n’est pas ce patriotisme saint et légitime mais la dérive sectaire de l’anarcho-gauchisme – sans oublier les tentacules de la Chine communiste. L’artiste patriote hésitera avant d’afficher publiquement son amour de la patrie par peur d’être ostracisé et de voir sa carrière compromise. Puisque dévier de la pensée unique implique des risques – ceux qui s’opposaient aux mesures sanitaires covidiennes en savent quelque chose – et que les électrons libres se font plutôt rares en 2022, l’artiste s’autocensurera. Les médias traditionnels, la classe politique et les intellectuels s’acharneront sur celui qui aura à se défendre seul, épié par une meute de journalistes assoiffés de sang. Elle est loin cette époque où les Pierre Falardeau et Michel Chartrand s’exprimaient librement et sans complexe. Les gouvernements gauchistes et mondialistes comme ceux d’Obama et Trudeau recevront, oui, quelques taloches ici et là, pour une mauvaise décision ou un scandale sortit de l’ombre, mais contrairement à un gouvernement conservateur ou nationaliste à la Trump, DeSantis ou Harper, qui lui sera talonné jour et nuit, les médias passeront rapidement à autre chose. Les médias revêtissent leurs habits de grands humanistes alors que derrière les portes closes, ils assaillent et musèlent leurs opposants, pour entre autres chaperonner les gouvernements. L’intolérance ne provient pas d’où certains le prétendent. C’est sans compter sur une banalisation pleine et entière des aléas catastrophiques du mondialisme. Cet aveuglement est volontaire lorsqu’il est lié à une rigidité doctrinaire ; involontaire lorsqu’il découle d’une naïveté rose bonbon. Les politiciens iront de plaidoyer en plaidoyer pour promouvoir l’immigration de masse ; les médias feront des reportages attendrissants sur les malheurs des migrants ; la droite économique prétendra qu’il y a une pénurie de main d’œuvre généralisée et sollicitera les gouvernements pour pallier à ce manque par l’immigration ; les artistes voudront être inclusifs, ne pas heurter les âmes sensibles. Nous sommes passés d’un marxisme de la lutte des classes à un marxisme culturel des races. La civilisation occidentale a été entièrement contaminée par une gauche pour qui une domination intégrale est un travail de longue haleine. Le libéralisme c’est une arme de destruction massive gauchiste.
L’évolution idéologique de l’artiste
La vie académique, les médias et les milieux culturels, littéraires, sportifs et musicaux ont tous été corrompus par une idéologie destructrice. C’est rendre la société docile et amorphe, c’est la neutraliser pour mieux la contrôler. Le progressisme auquel la gauche fait référence n’est rien d’autre qu’un puritanisme moderne qui s’exerce sous des aspects divers, comme le sanitarisme, le wokisme et le multiculturalisme. Se déguiser pour l’Halloween devient un défi, produire une œuvre aussi. L’art au service de la gauche radicale. Nous sommes les esclaves de la rectitude politique. Au-delà d’être solidaire à une idéologie politique, le milieu artistique perçoit dans le gauchisme son salut financier. L’étatisme bénéficie aux artistes (et aux médias) puisqu’il constitue une source non négligeable de revenus. Les subventions, les crédits d’impôt, les publicités, l’apport technologique et le financement d’organismes culturels procurent l’oxygène nécessaire à la survie d’une industrie en perpétuelle évolution. La culture, ciment de la nation canadienne-française, est fragilisée par la culture étatsunienne, la petitesse de son marché, le Web et le mondialisme. Le soutien du gouvernement devient indispensable. En présence d’un nombre limité d’employeurs et de producteurs, les artistes québécois dépendent du monopole public. Ils y voient un bienfaiteur, un sauveur, un incontournable. Ils lui seront redevables et estimeront, à tort, que l’État providence est la solution à tout problème. Ce lien s’estompera difficilement puisqu’ils se ligueront constamment à lui. Par prudence, mais aussi par pudeur, ils ne le critiqueront pas, si ce n’est que du bout des lèvres lorsque le besoin s’en fera sentir, surtout en période d’austérité budgétaire. Avec le temps, l’artiste, plus gourmand, revendiquera des ressources financières non plus comme une aide temporaire mais plutôt comme un droit, une obligation, un acquis. Quelques artistes, impassibles devant le charme gauchiste, se tairont par crainte de représailles et d’être marqués au fer rouge par un milieu militant et dépendant des fonds publics. Tel un acteur jouant la comédie, ils cacheront leurs véritables opinions pour poursuivre leur carrière, pour faire partie du groupe, celui qui diffame et stigmatise vicieusement quiconque s’oppose à lui. Le penseur Gilles Guénette écrivait déjà en 2012 :
« […] personne n’est obligé de s’afficher pour quoi que ce soit. Mais avouez qu’il est étrange qu’à toutes les fois qu’un artiste s’affiche au Québec, c’est toujours pour les mêmes causes, toujours du même bord. Pourquoi les artistes ont-ils peur de s’afficher comme autre chose que de gauche ? La raison qui revient le plus souvent, c’est qu’ils disent craindre les représailles. La solidarité, la tolérance et la compassion ne sont malheureusement plus des valeurs qui tiennent dans le milieu culturel québécois lorsque vient de temps de s’afficher à contre-courant de la majorité […] expliquant que certains d’entre eux craignent de perdre des subventions […]
Ça peut être compromettant pour une carrière et au niveau des relations professionnelles […] Ces gens-là ne sont pas atteints d’une maladie honteuse ou n’ont pas été reconnus coupables d’actes pédophiles. Ils ne pensent tout simplement pas comme leurs camarades et se positionnent ailleurs sur le spectre politique. C’est comme ça dans toutes les autres sphères d’activités de la société. Où sont les artistes qui ne sont pas de gauche ? Ils se cachent chez eux. Et ils ne disent leur opinion que sous le couvert de l’anonymat, terrorisés qu’ils sont à l’idée que leurs camarades découvrent ce qu’ils pensent vraiment.
Au fil des ans, le milieu culturel québécois s’est créé un réseau de financement public qui lui permet de faire fi un peu des règles du marché ‒ ces règles, les gens du milieu nous l’ont assez répété, ne s’appliqueraient pas à la culture qui n’est pas un produit de consommation comme les autres. Or, on se rend compte que ce réseau est noyauté par des gauchistes/étatistes et qu’il y règne un climat de peur et d’intolérance pour quiconque ne penserait pas comme ceux qui sont en position de pouvoir [2].»
Le comportement du milieu artistique correspond en tout point à l’attitude liberticide de la gauche. La sympathie que suscite les artistes s’avère être un défi gigantesque pour celui qui désire les contester. La culture, vitale pour la survie de notre nation, aura toujours besoin de la participation financière du gouvernement. C’est bien ainsi. Mais pour dépolitiser en partie la communauté artistique, les sources de revenus doivent se multiplier. L’une d’elle est le mécénat. Ce réflexe philanthropique est peu implanté chez nous. Le pavillon Pierre-Lassonde, imposant bâtiment appartenant au complexe muséal du Musée national des beaux-arts du Québec, témoigne de la réussite d’un projet audacieux conjuguant art, architecture, patrimoine et modernisme. La beauté des lieux met en relief le passé du Québec, par ses toiles, ses sculptures, ses objets anciens, mais aussi le présent, par son art contemporain et avant-gardiste. Le patrimoine québécois, en danger, gagnerait à ce que plus de donateurs patriotes contribuent à l’entretien de nos églises, de nos maisons ancestrales, de nos musées, de nos bibliothèques et au prolongement de nos coutumes, de nos traditions, de notre histoire. Les institutions militantes sont une autre forme de financement de la culture. Si la gauche et les mondialistes fourmillent d’organismes militants et de groupes de pression, les patriotes ont, eux, peu d’outils capables de canaliser leurs inspirations. À travers sa longue histoire, la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal fait figure de pionnière dans la promotion et la défense de ce peuple issu de la Nouvelle-France. Le patriotisme, si présent autrefois, et plutôt timide en ces temps mondialistes, doit reprendre sa place et s’inspirer des meilleures pratiques du passé. Encourageons et militons à l’intérieur d’organisations nationalistes ou de celles qui ont comme mission la préservation de notre être collectif – je pense à la Fondation Lionel Groulx, à la Maison nationale des Patriotes, à Action patrimoine. Le patriotisme doit se bâtir une carapace et les actions citoyennes doivent être indépendantes d’un pouvoir politique qui a trop souvent déçu et négligé ses devoirs nationalistes – le gouvernement québécois est devenu jusqu’à un certain point et tout particulièrement sous Charest et Couillard, un obstacle au patriotisme et à la résistance nationaliste. Nos élus regardent avec méfiance et même dégout le citoyen qui parle le langage du juste, celui du patriote. Quand le patriote devient un polémiste simplement parce qu’il est fidèle à sa terre natale.
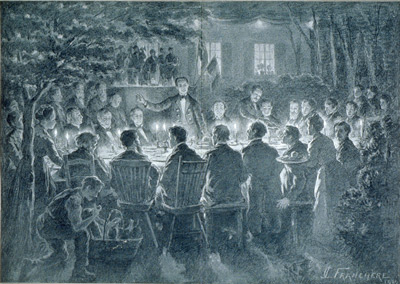
Une conscience morale guidera bien sûr aussi l’artiste. Celui-ci s’accomplira en jouissant de son génie créatif. La planète entière l’anime et lui sert de terrain de jeu. Il se dira citoyen du monde, disposé au sans-frontiérisme et à l’immigration massive. Il regardera l’immigrant d’un œil sympathique. Aimable, à fleur de peau, émotif, son univers sera fantasmagorique. Il croit que sa réussite et la fidélité de son public résultent de sa personnalité, de son jovialisme, de sa bienveillance, de son regard accueillant. En quête de popularité, il se montrera chaleureux. L’artiste, comme le politicien, est obsédé par son image. Que pensera le public de moi ? Qui m’engagera ? Il se sent obligé de plaire. Il évitera toute controverse et suivra le même chemin que les autres. Si le vent souffle vers le mondialisme, il s’y laissera flotter ; si le vent souffle au contraire vers le patriotisme, c’est vers là qu’il se dirigera. L’artiste ira où l’establishment lui dira d’aller. Les dérives autoritaires de la gauche ne l’effraie pas puisque son instinct grégaire le poursuit. Que le gauchisme conduit au socialisme puis au crédit social de type chinois ne l’inquiète pas.
L’artiste étudie règle générale dans des domaines rattachés aux sciences sociales et aux communications. Sa pulsion artistique le suit depuis longtemps. Il espère un monde meilleur, un monde huxleyien. Il souhaite que son pays ouvre ses frontières aux miséreux quitte à importer des profiteurs et des indésirables. Sa curiosité naturelle l’amènera à lire, à étudier, à bouquiner, mais comme son entourage est gangréné jusqu’à la moelle par le gauchisme et le mondialisme, ses lectures, ses rencontres, ses activités et ses amitiés en seront teintées. Son parcours l’amènera à s’imprégner et à idéaliser les écrits socialistes, communistes ou antinationalistes de Marx, Engels, Trotsky, Lénine, Sartre, des signataires du Refus global et des auteurs de la revue Cité libre, cette dernière étant le refuge québécois de l’anticléricalisme et du dogmatisme libéral. Chez nous, ces crédos politiques prirent de l’ampleur en réplique au duplessisme et devinrent la norme dès la Révolution tranquille, période qui remettait en cause nos valeurs traditionnelles et qui incitait les Québécois à s’ouvrir aux autres en adoptant l’internationalisme. C’était chasser le catholicisme, séculariser, laïciser, repartir à zéro sans nos symboles de toujours, ceux qui nous identifiaient, nous rendaient si fiers et uniques. Le 19è siècle puis le 20è siècle furent la suite logique du siècle des Lumières où l’individualisme et l’humanisme eurent un écho marqué. Progressivement l’égalitarisme, la lutte des classes, la justice sociale et le partage de la richesse furent des principes étudiés, reconnus et introduits dans le discours public. D’abord marginaux, ils s’infiltrèrent dans les sphères de la société, bien au-delà, j’imagine, des espérances de leurs initiateurs. Le communisme plaît encore malgré ses monstruosités.
La social-démocratie des années 1960 bouleversa notre route. Un désir d’émancipation s’abattait sur ce jeune peuple embourbé dans une Confédération canadienne désuète et sous domination anglaise. La nationalisation de l’électricité, la création d’institutions telles que la Régie des rentes et la Caisse de dépôt et de placement rendirent le Québec autonome économiquement. Notre richesse collective dépendait de la nouvelle fonction publique. La gauche se l’appropria et y plaça ses pions. Malgré l’efficacité de ces leviers économiques, politiques et culturels, les pouvoirs du Québec restaient limités par un gouvernement fédéral centralisateur. Cette époque vit des personnalités publiques emboiter le pas gauchiste. Nos plus grandes idoles affichaient un nationalisme de plus en plus à gauche, laissant des miettes à la droite. L’engagement politique très à gauche de ces piliers québécois aura inévitablement influé et charmé les générations subséquentes.
Le gouvernement Lesage créa le Ministère de la Culture en 1961 puis celui de l’Éducation en 1964. Ils seront les pierres d’assises de la vie culturelle québécoise à venir. Période euphorisante pour une gauche qui répandait alors une idéologie qui allait persister dans le temps. Cette direction politique, si orgasmique pour une gauche en expansion, donna l’élan nécessaire pour métamorphoser la société québécoise. La gauche croyait illuminer un Québec alors atteint d’une présumée grande noirceur. Elle devait, pour réussir à s’implanter, dénigrer et obscurcir le gouvernement précédent. Une révolution politique et culturelle s’opère avec succès si elle prétend réparer des pots cassés et corriger une situation déficiente. Pour que les citoyens acceptent un changement de paradigme politique, il fallait s’en prendre durement au gouvernement de l’Union nationale. Le milieu artistique profita de cet étatisme culturel et de ce dirigisme économique et devait dès lors s’assurer qu’ils tiennent le coup. Un milieu tissé serré qui regorge d’idéalistes qui aspirent à un monde sans discrimination et sans injustice – principes à géométrie variable comme le montra la crise covidienne. Nostalgique de ses luttes étudiantes, son gauchisme ne flanchera pas à moins que la guerre culturelle soit remportée par un autre clan idéologique. Plusieurs de ses actions quotidiennes entreront néanmoins en contradiction avec son laïus politique si articulé. Le confort et l’abondance l’épousent. Ses besoins changent. L’artiste continuera à promouvoir la générosité, l’entraide, les programmes sociaux, l’imposition des riches, l’écologisme et l’ouverture tandis qu’il nage dans le luxe, l’évasion fiscale, la surconsommation, l’égocentrisme et le snobisme. Il regarde l’identité historique de sa propre race s’enliser tel un naufragé qui contemple son embarcation couler au fond de l’eau. Malgré ses défauts, l’artiste peut redevenir un allié indélébile pour notre cause. Amenons-y.
Le patriotisme, si manifeste à certaines époques, chancelant à d’autres, trouve sa source en nous. Sa flamme ne sera jamais éteinte. Des porteurs de flambeaux restent, ici et là, vigilants et droits comme un chêne. Des éléments peuvent venir le troubler. À nous de tenir bon et de répondre aux assauts des ennemis de la nation.
[1] Dans la foulée de la controverse « Kanata », Sophie Prégent commentait dans lapresse.ca du 28 juillet 2018 le manque de diversité dans le milieu artistique.
[2] Extrait d’un texte publié au quebecoislibre.org.