Les foyers canadiens-français ont toujours aimé se rassembler autour d’un bon repas. Le temps semblait alors s’arrêter. Évidemment, les arts de la table dépassent les frontières du Québec. La nourriture est souvent synonyme de réconfort, d’enthousiasme, de plaisirs coupables, de moments heureux. Mais outre son caractère universel et essentiel (réponse à un besoin naturel), elle s’accompagne aussi de traditions et symbolise, à bien des égards, la manière de vivre d’un peuple, avec ses mœurs, ses pratiques, ses habitudes ; elle forge son identité tout comme peuvent le faire une langue, une religion et une couleur de peau.
Chez nous, il n’y a pas si longtemps, nos villages et nos villes grouillaient d’enfants et de jeunes rêveurs. Les familles nombreuses abondaient. La revanche des berceaux contribua au salut des Canadiens français. Elle fût encouragée par un clergé tantôt autoritaire mais néanmoins là pour nous, là pour donner un sens à notre vie, nous unir, nous guider, nous outiller moralement et intellectuellement, bref là pour qu’émerge un peuple digne et tenace qui saurait braver les tempêtes, surmonter les défaites, repousser ses limites et combattre les menaces d’assimilation. Aujourd’hui sans boussole spirituelle, notre peuple se meurt, se fond dans le multiculturalisme canadien, s’imbibe d’une idéologie mondialiste propagée à tout vent. L’ethnomasochisme s’invite de plus en plus dans un discours public qui place la haine de soi et la culpabilisation comme tendances à la mode – exercices incontournables d’une gauche déracinée qui déteint sur une droite économique qui ne se préoccupe pas tellement des changements démographiques que nous subissons, elle qui ne pense qu’au PIB et aux profits.
Notre société se métamorphose. Son libéralisme tapageur s’agenouille devant l’obscurantisme woke. C’est le culte à la diversité et à l’inclusion, leitmotiv occidental qui s’affiche maintenant partout : dans la musique, à la télé, au cinéma, dans les arts, dans les publicités, dans les écoles, dans les médias…et dans notre assiette. Les découvertes gastronomiques sont encouragées. Des chefs charismatiques crèvent l’écran, eux qui multiplient le sensationnalisme culinaire. Les librairies et les épiceries pullulent de nouvelles recettes, de nouveaux produits, de « saveurs du monde », d’exotisme. Ce marketing comble notre estomac et ajoute à notre créativité, c’est vrai, mais il nous éloigne de nos racines, de nos traditions, de notre terroir. Nous nous souvenons pourtant tous des plats savoureux préparés avec tendresse par notre mère, par nos grand-mères, par nos tantes. Des mets typiquement canadiens-français qui nous ressemblaient. Je me rappelle avec délice du fabuleux sucre à la crème et du pâté à la viande de ma grand-mère paternelle, de la compote de pommes « maison » de ma grand-mère maternelle, de nos virées à la cabane à sucre, des queues de castor mangées à Expo Québec, des crêpes onctueuses de mon grand-père que nous accompagnions d’un sirop d’érable de la région.
Les membres d’une même famille, réunis jadis à la table, après une prière de circonstance, qui se racontaient leur journée, planifiaient les prochaines vacances, faisaient honneur au talent de cuisinière de la maman, jouaient du coude pour le dernier morceau de pain ou le dernier beignet, fêtaient une réussite scolaire ou une victoire sportive. Une famille qui se retrouvait enfin tandis que le père revenait épuisé de la mine, de l’usine, du chantier, de la ferme ; que la mère attendait avec impatience sa marmaille et son homme ; que les enfants rentraient affamés et le visage pétillant de santé après s’être amusés dans la neige, à la patinoire, dans la rue. Tous ensemble pour jouir du moment présent. Ces images de bonheur dans la simplicité et dans l’essence même de la vie humaine se sont perdues quelque part dans l’individualisme, le modernisme et la superficialité de notre ère.
Il y a eu les repas animés et chaleureux d’une autre époque, où seulement le coucou de l’horloge, le chant des oiseaux, la colère de dame Nature et les rumeurs de la ville pouvaient détourner l’attention des convives. Puis, ceux accompagnés d’une boîte métallique, la radio, avec sa musique qui égayait les mois d’hiver et avec ses paroles qui quelquefois braillaient un manque d’amour. Survint une télévision qui fascina, brusqua nos habitudes et qui s’avéra soudainement indispensable, tel un membre à part entière de la famille, qui invitait aux confidences et aux rires – la radio et la télévision introduisaient une forme de dépendance qui allait devenir endémique plusieurs décennies plus tard. Les Occidentaux, consommateurs capricieux téléguidés par leurs cartes de crédit, distraits, absorbés par leurs gadgets électroniques, leurs téléphones intelligents, leurs tablettes, tous rivés à ces objets qui ont tant révolutionné notre quotidien, se sont déguisés en esclaves lunatiques d’une technologie et d’une réalité numérique qui mènent progressivement à un monde orwellien et huxleyien. Le 21e siècle, c’est celui qui rejette et réécrit le passé ; celui qui se moule à la facilité et au nivellement vers le bas ; celui des familles éclatées, du recul des valeurs traditionnelles et des contacts humains ; celui du regard vitreux qui fixe machinalement l’écran, le sol, à gauche, à droite, partout et nulle part à la fois. Le virus covidien aura accéléré cette marche vers la docilité, la solitude et la dépression. C’est la netflixisation d’une société nombriliste qui s’habitue à la paresse et qui se soumet facilement à un État maternant.
Au-delà des clichés comme la poutine, le pouding chômeur, la tourtière, la tire sur la neige, les pets de sœur, la tarte aux bleuets et le pâté chinois, ce sont avant tout les repas en famille, les souvenirs d’enfance, certaines odeurs et les fêtes populaires (Noël, Pâques, la St-Jean-Baptiste, etc.) qui entretiennent l’esprit, élèvent l’âme, définissent qui nous sommes en tant qu’individu, en tant que peuple. Notre mémoire collective, notre patrimoine et notre culture se construisent, se précisent, se continuent. La maison était le lieu privilégié pour nos discussions et nos échanges, un espace qui rappelait la camaraderie, les familiarités et les liens fraternels, et où la nourriture devenait complice de nos soirées, une excuse pour se réunir. L’agriculture était notre poumon économique. Nous respections un terroir québécois alors mis de l’avant avec orgueil et empressement. Nous avions un parti pris sans équivoque pour les nôtres. Ces gestes patriotiques menèrent, entre autres, à l’autosuffisance et à l’achat local. Mais nos traditions se heurtent désormais à une mondialisation vigoureuse et à un capitalisme effréné. La surconsommation marque notre temps. Les mets industriels dominent allégrement. La restauration rapide aussi. Manger sur le pouce sans interagir avec personne devient la norme. Le restaurant n’est plus que le refuge des buveurs de cafés et d’étudiants engourdis par leurs écouteurs et leurs cellulaires, le repère de la malbouffe et des repas à la va-vite − signes que la société s’est endormie comme un vieux fauve. Nous copions le modèle états-unien.
Citons nos auteurs
Laissons les mots de quelques-uns de nos plus illustres auteurs relater des scènes bien de chez nous, ces airs de famille, ces récits émouvants racontant l’histoire de ces hommes et de ces femmes d’hier qui, à leur façon, forgèrent humblement les bases de notre identité nationale. Nous voici dans une maison canadienne-française accueillante et là, parmi des travailleurs acharnés qui autour d’un bon feu jouissent d’un peu de répit en se délassant de légendes et de plaisanteries.
Dans Les Anciens Canadiens, Philippe Aubert de Gaspé brosse un vif portrait des mœurs canadiennes-françaises sous le régime seigneurial français. L’action se déroule d’abord en 1757, en Nouvelle-France, puis quelques années plus tard, sous la domination britannique. Les repas soulignent la gaieté inoubliable de nos ancêtres bien-aimés. Une tablée qui conserve une douce empreinte familiale et amicale et qui rime avec sérénité.
« Un immense buffet, touchant presque au plafond, étalait, sur chacune des barres transversales dont il était muni, un service en vaisselle bleue de Marseille. Au-dessus de sa partie inférieure, qui servait d’armoire, et que l’on pourrait appeler le rez-de-chaussée de ce solide édifice, projetait une tablette d’au moins un pied et demi de largeur, sur laquelle était une cassette, plus haute que large, dont les compartiments, bordés de drap vert, étaient garnis de couteaux et de fourchettes à manches d’argent, à l’usage du dessert. Cette tablette contenait aussi un pot d’argent, rempli d’eau, pour ceux qui désiraient tremper leur vin, et quelques bouteilles de ce divin jus de la treille.
Une pile d’assiettes, deux carafes de vin blanc, deux tartes, un plat d’œufs à la neige, des gaufres, une jatte de confitures, sur une table couverte d’une nappe blanche, près du buffet, composaient le dessert de ce souper d’un ancien seigneur canadien. À un des angles de la chambre était une fontaine, de la forme d’un baril, en porcelaine bleue et blanche, avec robinet et cuvette, qui servait aux ablutions de la famille. À un angle opposé, une canevette, garnie de flacons carrés, contenant l’eau-de-vie, l’absinthe, les liqueurs de noyau, de framboises, de cassis, d’anisette, pour l’usage journalier, complétait l’ameublement.
Une cuillère et une fourchette d’argent, enveloppées dans une serviette, étaient placées à gauche de chaque assiette, et une bouteille de vin léger à la droite. Point de couteau sur la table pendant le service des viandes : chacun était muni de cet utile instrument, dont les Orientaux savent seuls se passer. Si le couteau était à ressort, il se portait dans la poche, si c’était, au contraire, un couteau-poignard, il était suspendu au cou dans une gaine de maroquin, de soie ou d’écorce de bouleau.
Il y avait aussi à droite de chaque couvert une coupe ou un gobelet d’argent de différentes formes et de différentes grandeurs : les uns de la plus grande simplicité, avec ou sans anneaux, les autres avec des anses ; quelques-uns en forme de calice, avec ou sans pattes, ou relevés en bosse ; beaucoup étaient dorés en dedans.
Une servante, en apportant sur un cabaret le coup d’appétit d’usage, savoir, l’eau-de-vie pour les hommes et les liqueurs douces pour les femmes, vint prévenir qu’on était servi. Ils prirent place à table. La maîtresse de la maison donna la place d’honneur au vénérable curé, en le plaçant à sa droite.
Le menu du repas était composé d’un excellent potage (la soupe était alors de rigueur, tant pour le dîner que pour le souper), d’un pâté froid, appelé pâté de Pâques, servi, à cause de son immense volume, sur une planche recouverte d’une serviette ou nappe blanche, suivant ses proportions. Ce pâté était composé d’une dinde, de deux poulets, de deux perdrix, de deux pigeons, du râble et des cuisses de deux lièvres : le tout recouvert de bardes de lard gras. Le godiveau de viandes hachées, sur lequel reposaient, sur un lit épais et mollet, ces richesses gastronomiques, et qui en couvrait aussi la partie supérieure, était le produit de deux jambons de cet animal que le juif méprise, mais que le chrétien traite avec plus d’égards. De gros oignons, introduits çà et là, et de fines épices, complétaient le tout. Un point important en était la cuisson, d’ailleurs assez difficile ; car, si le géant crevait, il perdait alors cinquante pour cent de son acabit. Pour prévenir un événement aussi déplorable, la croûte du dessous, qui recouvrait encore de trois pouces les flancs du monstre culinaire, n’avait pas moins d’un pouce d’épaisseur. Cette croûte, imprégnée du jus de toutes ces viandes, était une partie délicieuse de ce mets unique.
Des poulets et des perdrix rôtis, recouverts de doubles bardes de lard, des pieds de cochon à la Sainte-Menehould, un civet bien différent de celui dont un hôtelier espagnol régala jadis l’infortuné Gil Blas, furent en outre les autres mets que l’hospitalité du seigneur de Beaumont put offrir à ses amis[1] […]
Le dîner, servi avec simplicité, fut néanmoins abondant, grâce au gibier dont grèves et forêts foisonnaient dans cette saison. L’argenterie était réduite au plus strict nécessaire ; outre les cuillères, fourchettes et gobelets obligés, un seul pot de forme antique, aux armes d’Haberville, attestait l’opulence de cette famille. Le dessert, composé des fruits de la saison, fut apporté sur des feuilles d’érable dans des cassots et des corbeilles qui témoignaient de l’industrie des anciens aborigènes. Un verre de cassis avant le repas pour aiguiser l’appétit, de la bière d’épinette faite avec les branches mêmes de l’arbre, du vin d’Espagne que l’on buvait presque toujours trempé, furent les seules liqueurs que l’hospitalité du seigneur d’Haberville pût offrir à ses convives : ce qui n’empêcha pas la gaieté la plus aimable de régner pendant le repas […]
Les anciens Canadiens lorsqu’ils étaient en famille, déjeunaient à huit heures. Les dames prenaient du café ou du chocolat, les hommes quelques verres de vin blanc avec leurs viandes presque toujours froides. On dînait à midi ; une assiettée de soupe, un bouilli et une entrée composée soit d’un ragoût, soit de viande rôtie sur le gril, formaient ce repas. La broche ne se mettait que pour le souper, qui avait lieu à sept heures du soir. »
De Gaspé a fait revivre certaines de nos plus belles coutumes. Il a insisté sur la bonne humeur et la jovialité qui habitaient nos ancêtres − cette « joie de vivre » qui nous a longtemps caractérisée et qui est devenue une expression française communément utilisée, même en langue anglaise. Il remémore ici, par le biais d’une conversation rythmée et pleine d’entrain, la plantation du Mai, rite célébré une fois l’an sur les rives du St-Laurent. Au menu : de la gourmandise, de l’amusement et un cérémonial pas piqué des vers.
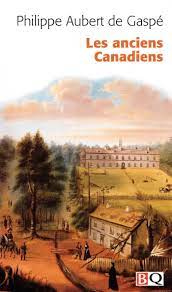
« – Viens, dit Jules à son ami : viens voir les apprêts qui se font pour le repas du matin des gens du mai.
Tout était mouvement dans la cuisine où ils entrèrent : les voix rieuses des femmes se mêlaient à celles des hommes de relais occupés à boire, à fumer et à les agacer. Trois servantes, armées chacune d’une poêle à frire, faisaient ou, suivant l’expression reçue, tournaient des crêpes au feu d’une cheminée, dont les flammes brillantes enluminaient ces visages joyeux, dans toute l’étendue de cette cuisine. Des voisines, assises à une table, versaient avec une cuillère à pot, dans les poêles, à mesure qu’elles étaient vides, la pâte liquide qui servait à confectionner les crêpes ; tandis que d’autres les saupoudraient avec du sucre d’érable à mesure qu’elles s’entassaient sur des plats, où elles formaient déjà des pyramides respectables. Une chaudière, à moitié pleine de saindoux frémissant sous l’ardeur d’un fourneau, recevait les croquecignoles que deux cuisinières y déposaient et retiraient sans cesse.
José, l’âme, le majordome du manoir, semblait se multiplier dans ces occasions solennelles. Assis au bout d’une table, les manches de la chemise retroussées, son couteau plombé à la main, il hachait avec fureur un gros pain de sucre d’érable. Il courait ensuite chercher la fine fleur et les œufs, à mesure que la pâte diminuait dans les bassins, sans oublier pour cela la table aux rafraîchissements, afin de s’assurer qu’il n’y manquait rien, et un peu aussi pour prendre un coup avec ses amis.
Jules et Arché passèrent de la cuisine à la boulangerie où l’on retirait une seconde fournée de pâtés en forme de croissants, longs de quatorze pouces : tandis que des quartiers de veau et de mouton, des socs et côtelettes de porc fais, des volailles de toute espèce, étalés sur des casseroles, n’attendaient que l’appoint du four pour les remplacer. Leur dernière visite fut à la buanderie, où cuisait, dans un chaudron de dix gallons, la fricassée de porc frais et de mouton, qui faisait les délices surtout des vieillards dont la mâchoire menaçait ruine.
– Ah çà ! dit Arché, c’est donc un festin de Sardanapale ! un festin qui va durer six mois !
– Tu n’en as pourtant vu qu’une partie, dit Jules ; le dessert est à l’avenant. Je croyais que tu étais plus au fait des usages de nos habitants. Le seigneur de céans serait accusé de lésinerie, si, à la fin du repas, la table n’était aussi encombrée de mets que lorsque les convives y ont pris place. Lorsqu’un plat sera vide, ou menacera une ruine prochaine, tu le verras aussitôt remplacé par les servants.
– J’en suis d’autant plus surpris, dit Arché, que vos cultivateurs sont généralement économes, plutôt portés à l’avarice qu’autrement ; alors comment concilier cela avec le gaspillage qui doit se faire, pendant les chaleurs, des restes de viandes qu’une seule famille ne peut consommer ?
– Nos habitants, dispersés à distance les uns des autres sur toute l’étendue de la Nouvelle-France, et partant privés de marchés, ne vivent, pendant le printemps, l’été et l’automne que de salaisons, pain et laitage, et, à part les cas exceptionnels de noces, donnent rarement ce qu’ils appellent un festin pendant ces saisons. Il se fait, en revanche, pendant l’hiver, une grande consommation de viandes fraîches de toutes espèces ; c’est bombance générale : l’hospitalité est poussée jusqu’à ses dernières limites, depuis Noël jusqu’au carême. C’est un va-et-vient de visites continuelles. Des carrioles arrivent ; on dételle aussitôt les voitures, après avoir prié les amis de se dégrayer ; la table se dresse, et, à l’expiration d’une heure tout au plus, cette même table est chargée de viandes fumantes.
– Vos habitants, fit Arché, doivent alors posséder la lampe d’Aladin !
– Tu comprends, dit Jules, que s’il leur fallait les apprêts de nos maisons, les femmes d’habitants, étant pour la plupart privées de servantes, seraient bien vite obligées de restreindre leur hospitalité, ou d’y mettre fin ; mais il n’en est pas ainsi : elles jouissent même de la société sans guère plus de trouble que leurs maris. La recette est simple : elles font cuire de temps à autre, dans leurs moments de loisir, deux ou trois fournées de différentes espèces de viandes, qu’elles n’ont aucune peine à conserver dans cet état, vu la rigueur de la saison. Arrive-t-il des visites, il ne s’agit alors que de faire réchauffer les comestibles sur leurs poêles toujours chauds à faire rôtir un bœuf pendant cette époque de l’année : les habitants détestent les viandes froides.
C’est un plaisir, ajouta Jules, de voir nos Canadiennes, toujours si gaies, préparer ces repas improvisés : de les voir sur un pied ou sur l’autre, tout en fredonnant une chanson, ou se mêlant à la conversation, courir de la table qu’elles dressent à leurs viandes qui menacent de brûler, et, dans un tour de main, remédier à tout : de voir Josephte s’asseoir avec les convives, se lever vingt fois pendant le repas, s’il est nécessaire pour les servir, chanter sa chanson, et finir par s’amuser autant que les autres.
Tu me diras que ces viandes réchauffées perdent de leur acabit ; d’accord pour nous qui sommes habitués à vivre d’une manière différente ; mais comme l’habitude est une seconde nature, nos habitants n’y regardent pas de si près ; et, comme leur goût n’est pas vicié comme le nôtre, leurs repas, arrosés de quelques coups d’eau-de-vie, ne leur laissent rien à envier du côté de la bonne chère. Allons maintenant rejoindre mes parents qui doivent s’impatienter de notre absence, que je considère comme autant de temps dérobé à leur tendresse. J’ai cru te faire plaisir en t’initiant davantage à nos mœurs canadiennes de la campagne, que tu n’as jamais visitée pendant l’hiver […]
Ce fut ensuite un feu de joie bien nourri qui dura une bonne demi-heure. On aurait pu croire le manoir assiégé par l’ennemi. Le malheureux arbre, si blanc avant cette furieuse attaque, semblait avoir été peint subitement en noir, tant était grand le zèle de chacun pour lui faire honneur. En effet, plus il se brûlait de poudre, plus le compliment était supposé flatteur pour celui auquel le mai était présenté.
Comme tout plaisir prend fin, même celui de jeter sa poudre au vent, M. d’Haberville profita d’un moment où la fusillade semblait se ralentir, pour inviter tout le monde à déjeuner. Chacun s’empressa alors de décharger son fusil pour faire un adieu temporaire au pauvre arbre, dont quelques éclats jonchaient la terre ; et tout rentra dans le silence.
Le seigneur, les dames et une douzaine des principaux habitants choisis parmi les plus âgés, prirent place à une table dressée dans la salle à manger habituelle de la famille. Cette table était couverte des mets, des vins et du café qui composaient un déjeuner canadien de la première société ; on y avait aussi ajouté, pour satisfaire le goût des convives, deux bouteilles d’excellente eau-de-vie et des galettes sucrées en guise de pain. Il n’y avait rien d’offensant pour les autres convives exclus de cette table ; ils étaient fiers, au contraire, des égards que l’on avait pour leurs parents et amis plus âgés qu’eux.
La seconde table, où trônait Raoul, était servie comme l’aurait été celle d’un riche habitant en pareilles circonstances. Outre l’encombrement de viandes, chaque convive avait près de son assiette la galette sucrée de rigueur, un croquecignole, une tarte de cinq pouces de diamètre, plus forte en pâte qu’en confiture, et de l’eau-de-vie à discrétion. Il y avait sur la table des bouteilles de vin auxquelles personne ne faisait attention ; ça ne grattait pas assez le gosier, suivant leur expression énergique. Ce vin avait été mis plutôt pour les voisines et les autres femmes occupées alors à servir, qui remplaceraient les hommes après leur départ.
À la troisième table, présidait Jules. Cette table à laquelle tous les jeunes gens de la fête avaient pris place, était servie comme celle de Raoul. Quoique la gaieté la plus franche régnât aux deux premières tables, on y observait néanmoins un certain décorum ; mais, à celle du jeune seigneur, surtout à la fin du repas, qui se prolongea tard dans la matinée, c’était un brouhaha à ne plus s’entendre parler[2].
Le lecteur se trompe s’il croit que le malheureux mai jouissait d’un repos après les assauts qu’il avait déjà reçus ; les convives quittaient souvent les tables, couraient décharger leurs fusils, et retournaient prendre leurs places après cet acte de courtoisie.
Au dessert, le seigneur, accompagné des dames, rendit visite aux convives de la seconde et de la troisième table, où ils furent reçus avec de grandes démonstrations de joie. On dit un mot affectueux à chacun ; il but à la santé des censitaires, les censitaires burent à sa santé et à celle de sa famille, au milieu des détonations d’une vingtaine de coups de fusil que l’on entendait au dehors.
Cette cérémonie terminée, M. d’Haberville, de retour à sa table, fut prié de chanter une chanson à laquelle chacun se prépara à faire chorus.
Chanson du seigneur d’Haberville
Ah ! que la table :
Table, table, table
Est une belle invention !
Pour contenter ma passion
Buvons de ce jus délectable
Honni celui qui n’en boira
Et qui ne s’en barbouille
Bouille, bouille :
Honni celui qui n’en boira,
Et ne s’en barbouillera !
Lorsque je mouille
Mouille, mouille, mouille
Mon gosier de cette liqueur
Il fait passer dedans mon cœur
Quelque chose qui le chatouille
Honni, etc.
À peine cette chanson était terminée, que l’on entendit la voix sonore de Raoul :
Oui, j’aime à boire, moi
C’est là ma manie
J’en conviens de bonne foi
Chacun a sa folie
Un buveur vit sans chagrin
Et sans inquiétude
Bien fêter le dieu du vin
Voilà sa seule étude
Oui, j’aime à boire, moi
C’est là ma manie
J’en conviens de bonne foi
Chacun a sa folie
Que Joseph aux Pays-Bas
Aille porter la guerre
Moi, je n’aime que les combats
Qu’on livre à coups de verre
Oui, j’aime, etc. »
Les décennies passèrent. Le 20e siècle se pointa le bout du nez et les familles canadiennes-françaises, malgré leur relative pauvreté, les querelles politiques du jour, les tensions internationales, une économie imprévisible, les bouleversements sociaux, les innovations technologiques et les avancées scientifiques, poursuivaient leur petit bonhomme de chemin dans les aléas de la vie. Félix Leclerc a su émouvoir ses lecteurs avec son magnifique roman Pieds nus dans l’aube. Son talent nous aura permis de suivre les traces d’un enfant qui ne voulait pas grandir, les pas d’un garçon issu d’une famille tissée serrée qui demeurait dans un Québec encore attaché à ses traditions, toujours fidèle à sa culture et à ses croyances.
« Lorsque nous étions réunis à table et que la soupière fumait, maman disait parfois :
– Cessez un instant de boire et de parler.
Nous obéissions.
– Regardez-vous, disait-elle doucement.
Nous nous regardions sans comprendre, amusés.
– C’est pour vous faire penser au bonheur, ajoutait-elle.
Nous n’avions plus envie de rire.
– Une maison chaude, du pain sur la nappe et des coudes qui se touchent, voilà le bonheur, répétait-elle à table.
Puis, le repas reprenait tranquillement. Nous pensions au bonheur qui sortait des plats fumants, qui nous attendait dehors au soleil. Et nous étions heureux. Papa tournait la tête comme nous, pour voir le bonheur jusque dans le fond du corridor. En riant, parce qu’il se sentait visé, il demandait à ma mère :
– Pourquoi tu nous y fais penser, à ce bonheur ?
Elle répondait :
– Pour qu’il reste avec nous le plus longtemps possible. »

Derrière ce tableau attendrissant se cachait surtout un père de famille qui, pour nourrir les siens, devait parfois partir au loin. Au cours de ces longues heures, dans le labeur et la sueur, ces bâtisseurs écrivirent un chapitre important de notre histoire. Pourquoi ne pas nous retremper dans l’univers d’Honoré Beaugrand qui, à travers ses légendes, a reproduit la routine de ces travailleurs infatigables qui défrichèrent le sol laurentien en incarnant une virilité et un courage dont se drapent de moins en moins leurs héritiers du 21e siècle. Faisons parler La chasse-galerie qui, par son jargon et sa verve, a conjugué des parties du folklore canadien-français avec les traits de personnalité d’hommes qui avaient du cœur au ventre.
« Le bourgeois avait, selon la coutume, ordonné la distribution du contenu d’un petit baril de rhum parmi les hommes du chantier, et le cuisinier avait terminé de bonne heure les préparatifs du fricot de pattes et des « glissantes » pour le repas du lendemain. La mélasse mijotait dans le grand chaudron pour la partie de tire qui devait terminer la soirée.
Chacun avait bourré sa pipe de bon tabac canadien, et un nuage épais obscurcissait l’intérieur de la cabane, où un feu pétillant de pin résineux jetait cependant, par intervalles, des lueurs rougeâtres qui tremblotaient en éclairant, par des effets merveilleux de clair-obscur, les mâles figures de ces rudes travailleurs des grands bois.
Joe, le cook, était un petit homme assez mal fait, que l’on appelait généralement le bossu, sans qu’il s’en formalisât, et qui faisait chantier depuis au moins quarante ans. Il en avait vu de toutes les couleurs dans son existence bigarrée, et il suffisait de lui faire prendre un petit coup de jamaïque pour lui délier la langue et lui faire raconter ses exploits […]
C’était un soir comme celui-ci, la veille du jour de l’an, il y a de cela trente-cinq ans. Les camarades et moi, nous prenions un petit coup à la cambuse. Mais si les petits ruisseaux font les grandes rivières, les petits verres finissent par vider les grosses cruches, et, dans ces temps-là, on buvait plus sec et plus souvent qu’aujourd’hui. Il n’était pas rare de voir finir les fêtes par des coups de poings et des tirages de tignasse. La jamaïque était bonne – pas meilleure que ce soir – mais elle était bougrement bonne, je vous le persuade !
J’en avais bien lampé une demi-douzaine de petits gobelets, pour ma part; et sur les onze heures, je vous l’avoue franchement, la tête me tournait, et je me laissai tomber sur ma robe de carriole pour faire un petit somme, en attendant l’heure de sauter à pieds joints, par-dessus la tête d’un quart de lard, de la vieille année dans la nouvelle, comme nous allons le faire ce soir sur l’heure de minuit, avant d’aller chanter la guignolée et souhaiter la bonne année aux hommes du chantier voisin. »
Beaugrand a dépeint le Québec d’alors, c’est-à-dire celui d’un 19e siècle sujet à de grandes transformations, qui vit par exemple l’industrialisation chambouler le paysage canadien. Mais la forêt, le bois et le grand air, terrains de jeux du bucheron, restèrent le point d’ancrage d’une jeune société canadienne-française. Ce peuple supposément « sans histoire et sans littérature » est beau. Tout simplement.

− « Les objets nécessaires pour une expédition de bucherons du Canada […] sont les cognées, une scie, des vases culinaires, un tonneau de rhume, des pipes, du tabac, du porc, du bœuf, des poissons salés, des pois, de l’orge, un petit tonneau de mélasse pour sucrer une espèce de thé qu’ils font avec décoction de plantes inconnues. Trois jougs de bœufs et le foin pour nourrir sont encore indispensables pour sortir les arbres abattus des forêts. Ainsi approvisionnés, des hommes, après avoir passé des marchés avec des marchands de bois, remontent les rivières pour se livrer à leurs travaux d’hiver. Arrivés sur le lieu de l’exploitation, ils abattent quelques arbres, forment une espèce de hutte couverte en écorce de bouleau, au milieu de laquelle ils allument un grand feu.
Autour de ce feu, ils étendent des lits de branchages, de feuilles ou de paille, sur lesquels ils reposent la nuit, les pieds tournés vers le foyer. Avec eux ils ont amené un homme chargé de faire la cuisine, de préparer le déjeuner avant l’aube du jour, époque à laquelle ils se lèvent et prennent ce repas, qui est toujours précédé d’un verre de rhum. Le déjeuner, ainsi que le dîner et le souper, consistent en pain, bœuf, porc ou poisson et soupe aux pois, aliments qu’ils délaient par une grande quantité de leur thé indigène Ces bucherons mangent au-delà de toute expression et boivent des quantités énormes de rhum[3]. »
− « Dans le camp, l’élément central est la cambuse, le foyer rustique, autour de laquelle se regroupent les bucherons pour manger, boire, fumer, veiller, se raconter des histoires, danser, faire des tours de force[4]. »
Pour gagner la guerre culturelle, celle qui change les mentalités populaires, nous devons au préalable savoir d’où nous venons, qui nous sommes, ce que nous voulons. Comme la musique, le théâtre, la littérature et le cinéma, notre rapport à la nourriture définit notre nature, notre conduite, notre manière d’être. Il découle de notre territoire, de notre climat, de nos relations, de nos racines françaises et catholiques. Notre devoir est de présenter l’histoire telle qu’elle fut vécue par nos ancêtres, d’honorer ces personnages plus grands que nature, de transmettre notre savoir-faire, de valoriser notre patrimoine et d’insuffler une mégadose de patriotisme à un peuple qui, hélas, en manque cruellement. Le mondialisme aura largement contribué à l’effritement de notre sentiment de fierté. Si notre objectif est de perpétuer la race canadienne-française et de la doter d’un foyer national, il faut d’abord la comprendre, la connaître, la respecter, la chérir, pour qu’enfin elle puisse rejaillir partout, sans honte.
S’exprimer. Se sentir fort. Défendre les nôtres. S’épanouir. Notre aventure nord-américaine se poursuivra encore et toujours.
[1] Notes ajoutées par de Gaspé : « Les anciens Canadiens ne buvaient généralement que du vin blanc au dessert […] Les habitants se servaient toujours, il y a 50 ans, de leur couteau de poche pendant les repas ; les hommes, de couteaux plombés ; les femmes se servaient de couteaux de poche ordinaires, qu’elles achetaient chez les boutiquiers […] Quelques familles canadiennes avaient conservé l’usage des gobelets d’argent pendant leurs repas, il y près de 70 ans. On y ajoutait les verres à patte de cristal au dessert, dont les convives se servaient indifféremment, suivant leur soif plus ou moins vive. L’ivrognerie était alors un vice inconnu à la première classe de la société canadienne. »
[2] Autres notes ajoutées : « Les enfants des cultivateurs ne mangeaient autrefois à la table de leur père et mère qu’après leur première communion. Il y avait, dans les familles aisées, une petite table basse pour leur usage ; mais généralement les enfants prenaient leur repas sur le billot ; il y en avait toujours plusieurs dans la cuisine, qui était quelque fois la chambre unique des habitants. Ces billots suppléaient dans l’occasion à la rareté des chaises, et servaient aussi à débiter et hacher la viande pour les tourtières et les pâtés des jours de fêtes. Il ne s’agissait que de retourner le billot suivant le besoin. Dans leurs querelles, les enfants plus âgés disaient aux plus jeunes : Tu manges encore sur le billot ! ce qui était un cruel reproche pour les petits […] Les anciens Canadiens détestaient le thé. Les dames en prenaient quelquefois, comme sudorifique, pendant leurs maladies, donnant la préférence, néanmoins, à une infusion de camomille. »
[3] Dans Les Quatre saisons (Boréal, 1996), l’auteur Jean Provencher cite un article de 1832 du Magasin du Bas-Canada, journal littéraire et culturel de l’époque.
[4] Extrait de Forestiers et voyageurs de Joseph-Charles Taché (1863).




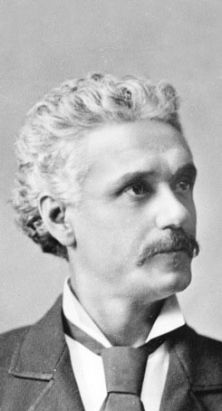
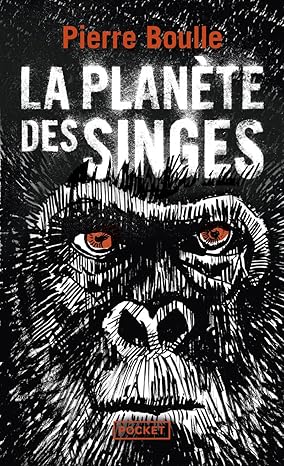


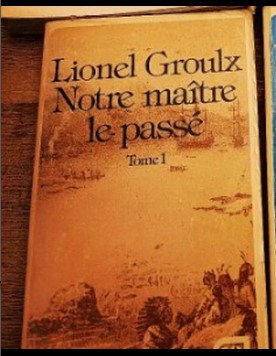
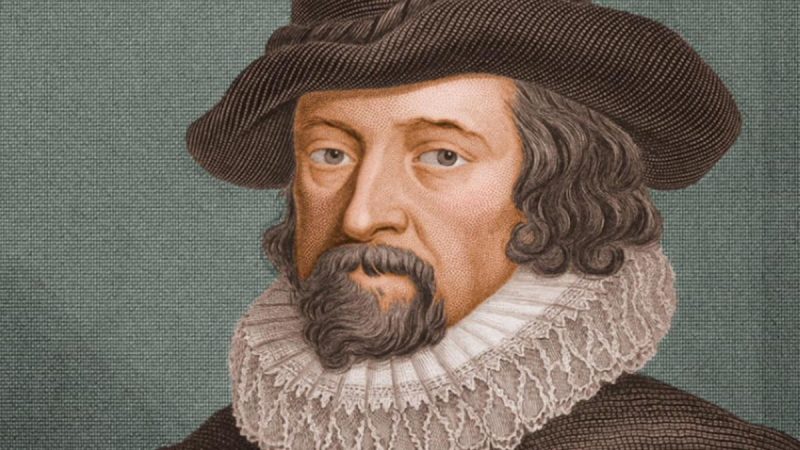



2 Responses
Merci beaucoup Sylvain pour ces beaux moments de lecture de notre histoire, malheureusement trop peu connue. . . .
L’histoire du Québec ne nous a pas été enseignée ou pour moi, seulement en première année d’école primaire. Un petit livre où il y avait des dessins colorés en brun, si je me souviens bien. C’est très flou dans ma mémoire. Mon frère n’en a aucun souvenir. Ce cours a été retiré des programmes scolaires réguliers. . . .
Merci pour le commentaire