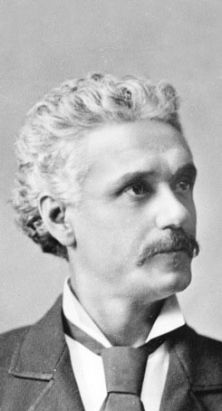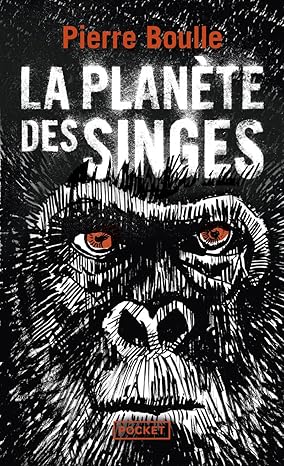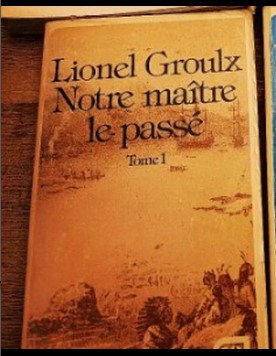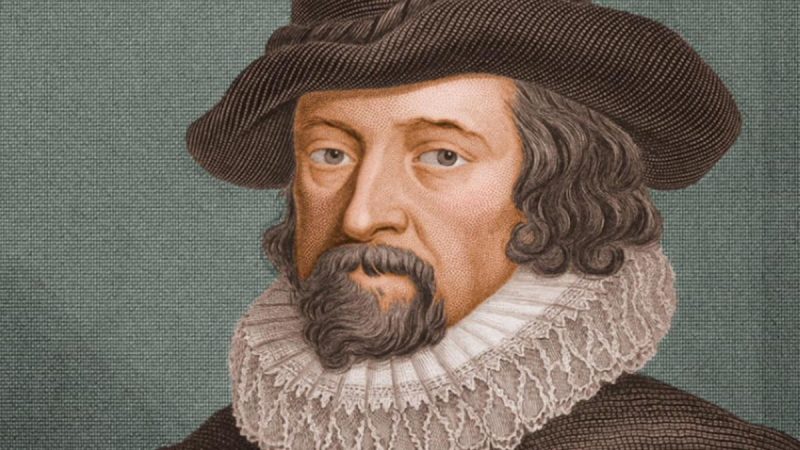La « politique » n’a rien de simple. Derrière ses acteurs se cachent un régime politique et plus largement, la démocratie, principe millénaire aux multiples visages. Certains l’adulent, comme le faisait René Lévesque, d’autres la ridiculisent, la critiquent, s’en méfient. Les politiciens qui se drapent sous de faux habits vertueux l’évoquent parfois de manière superficielle et habile, dans un flot de phrases creuses et de clichés, dans le but de légitimer une décision, de s’en servir comme outil partisan capable de paralyser voire diaboliser un adversaire (le point Godwin n’étant jamais bien loin) ou de brandir une réputation surfaite de grand démocrate à l’écoute des gens.
L’arrivée des médias sociaux changea la donne. Un nouveau genre de marketing politique faisait son apparition. Un politicien peut, comme le fit Justin Trudeau, y mousser sa candidature, soigner son image et faire passer un message. En revanche, il s’expose aussi à devenir la cible de petits génies à la recherche du moindre écart de conduite, c’est-à-dire de la photo choc, du mot de trop, de la menue controverse. Si sourire à belles dents devient maintenant la normalité, c’est que le contenant, si riche en clics et en amour-propre, importe plus qu’un contenu soumis à la langue de bois – merci à la ligne de parti et à l’autocensure d’une société aseptisée et ramollie par des décennies d’un gauchisme cosmopolite castrant. C’est prioriser le pouvoir, l’avancement, le prestige, c’est en quelque sorte le règne de l’arrivisme, du carriérisme et de la superficialité, c’est voir la vie à travers un prisme déformant.

Quand la démocratie déraille
La démocratie, nous le savons trop bien, c’est aussi le clientélisme électoral, les renvois d’ascenseur, le favoritisme, le lobbying, la partisanerie, tous des moteurs au cynisme ambiant et à l’écœurement populaire. Les compétences d’un individu deviennent soudainement secondaires lors de la formation du Conseil des ministres – le Premier ministre le compose de façon à satisfaire des égos, à préparer sa réélection, à accommoder ici et là, à faire plaisir aux hérauts de la diversité et de la parité. Bref, c’est calculer selon les impératifs politiques du moment et obéir aux exigences d’une grille prédéfinie.
Le politicien de 2023 brasse des intérêts plutôt que des idées. Si des idéalistes subsistent (pensons aux péquistes sincères dans leurs convictions indépendantistes ou aux droitards épris de libertés individuelles), ils sont nombreux à ne miser que sur le style et l’enrobage, chacun devenant une caricature du politicien postiche et interchangeable – une version moderne du courtisan de la Cour de Versailles. Un tel politicien prend la peau d’un caméléon sensible aux vents contraires, n’assumant que rarement un commentaire jugé « problématique ». Il préférera se munir d’un sauve-conduit médiatique pour aller siroter un verre de vin sur les plateaux de télévision. Les sondages qui abondent en période électorale nuisent aussi à l’exercice démocratique : ils incitent à voter stratégiquement et influencent, indirectement, la psyché collective.
Une démocratie optimale supposerait un député qui représente à la lettre les électeurs de son comté. Il serait le voisin, l’ami ou le collègue qui se bat pour sa communauté. Mais les grands enjeux de société seraient alors enfouis sous un amas de chicanes de clôtures et de rues pas déneigées. Les partis politiques deviennent donc un mal nécessaire, sans quoi une instabilité chronique pourrait s’installer. Pour un peuple comme le nôtre, isolé et fragilisé par son statut de minorité démographique à même un continent anglo-saxon et multiculturel, parler d’une voix ferme et décidée n’est pas un caprice. Surtout devant Ottawa et Washington. Un Québec sous le joug répété de gouvernements de coalition se morcellerait. La force canadienne-française qui, d’ordinaire, peut s’affirmer dans le gouvernement québécois, en serait venue à quémander à gauche et à droite chaque mesure, qu’elle soit nationaliste ou non. Un pouvoir dilué altère notre capacité d’agir et de réagir.
Un gouvernement fort, donc, très nationaliste si possible, imputable non seulement en période électorale, mais également en période un peu plus agitée, afin d’éviter les abus arbitraires de type covidien.
« Ils aiment à répéter que si le peuple n’est pas d’accord avec leurs attitudes, il n’a qu’à les démettre aux prochaines élections. Principe incontestable mais insuffisant (…) Pris à lui seul, ce principe pourrait se ramener à ceci : une fois élu, vous pouvez faire n’importe quoi entre deux élections. [i]»
La démocratie libérale telle que nous la connaissons bat de l’aile. Beaucoup de citoyens, peu importe le pays, l’État ou le régime politique, peinent à croire en elle. Des fraudes électorales fausseraient des résultats ; les taux de participation aux élections ne cessent de dégringoler ; les institutions deviennent des mal-aimées. Une crise de confiance sans précédent touche la racine même de notre vie démocratique.
La démographie, c’est le destin, dit-on. Elle bouleverse nos habitudes et notre mode de vie. Si l’immigration massive métamorphose le tissu social, elle amène aussi une mise à jour des tactiques électorales, davantage axées sur la micropolitique et une segmentation minutieuse des électeurs − une tyrannie des minorités (une « minocratie »). La démocratie, qui se veut au préalable quelque chose de noble et de réfléchie, commande en contrepartie des dépenses folles (en publicités, dans l’organisation d’une campagne électorale, dans la gestion d’un parti, etc.) et des jeux de coulisses : voilà le pouvoir de l’argent et des médias. C’est se présenter sous les traits d’un personnage de fiction, comme une espèce d’homme-robot, car le politicien moderne, pour soutirer l’appui des électeurs devra acter, simuler, se préparer des répliques, sortir la cassette.
Nous sommes à une époque apparemment ouverte sur le monde, exubérante, dans laquelle la liberté artistique s’exprime sans complexe et où le respect des libertés individuelles s’inscrit dans l’ABC du discours public. Parallèlement, elle ne permet toutefois pas de dévier du schéma narratif dominant. En sortir ne pardonne pas. Chaque mot est scruté à la loupe. La rectitude politique devient la norme, un atout.
Alors que faire ? Conserver la démocratie ? Oui, probablement, mais quel régime politique répondrait le mieux aux besoins et aux desseins de notre peuple ? Quel régime saurait préserver la nation canadienne-française ? La Nouvelle-France, fruit d’une France royaliste qui colonisa ces quelques arpents de neige, a su, dans le labeur, la sueur, le sang, par de l’ingéniosité et du courage, progresser et se développer en dépit d’une lointaine métropole française trop occupée à guerroyer en Europe. La présence d’un gouverneur, digne représentant du roi de France, assura une stabilité administrative et politique à une toute jeune colonie qui, malgré son infériorité démographique, un hiver qui n’en finissait plus, ses insuccès militaires et la menace iroquoise, se déploya fièrement à travers l’Amérique. Fait exceptionnel, la Nouvelle-France n’a connue, en 151 ans d’histoire, que quatre souverains : Henri IV, Louis XIII, Louis XIV et Louis XV. Ce signe de continuité détonne avec les gouvernements actuels qui se succèdent bien souvent à un rythme effréné. Une démocratie constamment en mode électoral où le Premier ministre jongle avec mille et une ruses pour conserver son poste. Si un monarque de droit divin pouvait à l’occasion être contesté (pensons aux frondes et à son point d’exclamation, la Révolution), la longue histoire française a pu démontrer que sa monarchie, quoique imparfaite, avait su procurer à l’État français une forme indéniable d’équilibre et de durabilité. Alors que 1789 prédestinait la France à une période de turbulence qui allait durer un siècle, la solidité de la monarchie constitutionnelle britannique, elle, permettait à l’Angleterre d’entamer sa révolution industrielle.
À priori loufoque, l’idée de réhabiliter puis de rétablir, en France, un régime royaliste, n’est plus un phénomène anecdotique. Selon ses partisans, le royalisme garderait toute sa valeur politique, toute sa pertinence, même à notre époque. Plusieurs royalistes le disent franchement : le régime républicain et la démocratie parlementaire accumulent les revers, les satires et les déceptions. La monarchie, c’est l’arbitraire et l’autoritarisme, répliqueront ceux emportés par une passion républicaine. Le despotisme ne se résume pourtant pas aux pires régimes bananiers. La démocratie libérale n’est pas à l’abri des dérives, la crise covidienne étant là pour le rappeler. D’aucuns pourraient taxer ces royalistes de réactionnaires, qu’une société moderne et progressiste doit toujours regarder en avant, pas en arrière. Mais si une société s’est trompée de direction, et qu’elle s’en rend compte, ne devrait-elle pas se ressaisir et repartir du bon côté ? Une société ancrée dans la social-démocratie est-elle condamnée à virer toujours plus à gauche ? Le conservatisme est-il destiné à n’être désormais qu’une philosophie politique arriérée ? Que le Québec préserve dans sa personnalité collective un fond bleu n’a-t-il plus aucune importance ? Cette nostalgie de l’ancien canadien n’est pas un frein à notre avenir, au contraire, si elle repose sur qui nous sommes vraiment – un peuple d’essence française et catholique.
En quête constante d’un élu providentiel, d’un sauveur, d’un héros ou d’un je-ne-sais-quoi insignifiant, les régimes démocratiques pullulent en fabulateurs, en beaux parleurs, en carriéristes et en m’as-tu-vu, tous doués pour charmer un électorat las de ces faux-culs. La méfiance des citoyens vis-à-vis les politiciens et les institutions, ainsi que les changements démographiques qui métamorphosent nos rues et nos villes, suggèrent un futur mouvementé et chaotique. On en revient à un chef d’État capable d’affronter ces chambardements et qui, d’une poigne de fer, sera en mesure de rétablir l’ordre tout en remettant à l’État les clés de la stabilité politique, elle qui passe inévitablement par le retour à l’avant-scène de nos traditions et de notre folklore, sources de réconfort et de fierté. Quelqu’un qui s’entoure aussi des meilleurs talents, comme ces rois de France qui surent profiter du brio de grands serviteurs de l’État – les Sully, Richelieu et Colbert laissèrent par exemple des traces indélébiles dans l’histoire politique française.
La démocratie est-elle une cryptotyrannie ?

Selon certains naïfs, la démocratie serait une garantie ou une assurance tous risques contre la tyrannie. Mais de qu’elle tyrannie parle-t-on ? Par le sang ? Par la violence ? Par le bâillonnement et l’emprisonnement de tout type d’opposition ? Et si elle était plus sournoise, plus effacée : l’omnipotence d’un « gouvernemaman » qui intervient partout et qui voit tout (« Big Brother »), l’influence des groupes de pression et des firmes d’experts-conseils (ces gouvernements fantômes à la McKinsey) et l’emprise d’une pensée unique qui conduit à la rectitude politique et à l’autocensure.
L’absolutisme royal générait de l’autoritarisme, c’est vrai, le souverain pouvant asseoir son autorité et conforter son pouvoir. Sans partage s’il le fallait. De nos jours, le poste de Premier ministre confère un pouvoir presque illimité à un seul individu. Dopé par ce pouvoir, empêtré dans la partisanerie, le népotisme et le copinage, il en vient à oublier pourquoi il a été élu. Le pouvoir aveugle les politiciens et ce sont les citoyens qui, désemparés et sans ressource, en subissent les conséquences.
Les régimes démocratiques, issus d’une soi-disant reprise du pouvoir par le peuple, ont engendré une bourgeoisie 2.0, une oligarchie ploutocratique qui ne se distingue plus que par l’argent et ses relations privilégiées avec le pouvoir politique. L’ascendant des élites sur la sphère politique n’est donc pas propre au monarchisme. Le démocratisme, démocratie absolue qui prétend faire du vote populaire la seule légitimité du pouvoir, atomise en réalité l’électorat, déresponsabilise les citoyens, favorise la partisanerie et participe à la construction d’idéologies contraires au bien-être de la nation canadienne-française. C’est une dépersonnalisation d’un humain numéroté et robotisé.
En démocratie, le peuple serait souverain, celui qui peut élire ou réélire un député, faire ou défaire un gouvernement. Ce mythe, très répandu, disparaît dès que nous comprenons comment fonctionne l’État. Les électeurs ne désignent que leurs représentants, leurs dirigeants, autrement dit ceux qui siègeront en chambre. Ils devront ensuite les endurer, les subir…et se la boucler. Ils ont également à obéir à un État de plus en plus encombrant, gênant et liberticide. Une loi n’est ni l’expression de la volonté générale ni un outil démocratique : elle est un instrument politique et idéologique, toujours plus « progressiste », si ce mot veut encore dire quelque chose. Une société qui fait table rase de ses traditions, de ses coutumes et de ses valeurs devenues présumément archaïques – la famille traditionnelle, la foi, la solidarité, le travail, l’effort et le patriotisme. Le Québec s’est construit, brique par brique, à partir de valeurs catholiques. De génération en génération. Puis tout s’est écroulé, comme partout ailleurs en Occident.
En 2023, le gouvernement québécois, avec son régime des partis et son adhésion au mondialisme, dilapide les fonds publics, gruge nos libertés et érode notre souveraineté politique. L’unité canadienne-française n’aura jamais été aussi forte qu’en Nouvelle-France, alors colonie d’une France monarchique, tandis que sous le parlementarisme britannique, à tort ou à raison, s’amorçait, sur la question nationale, une désunion, des luttes fratricides, la victoire d’un clan sur un autre, d’une idéologie sur une autre. Une démocratie qui fonde son existence sur la division et des affrontements contre-productifs. S’entredéchirer pour des peccadilles dans un contexte où une mer anglophone assimilatrice et un vent multiculturaliste se déchaînent sur une pauvre petite chaloupe dont les matelots rament à contresens, comme des poules pas de tête, sans direction ni cadence.
La démocratisation de certains secteurs, dont celui de l’éducation, aura permis une forme de progrès social, une égalité des chances, un encadrement essentiel au développement socio-économique du Québec. Depuis que l’État en a la mainmise, l’école d’aujourd’hui, criblée de dogmes gauchistes et mondialistes, s’affaire à corrompre l’esprit des jeunes. Une éducation basée sur une idéologie qui déstructure la pensée en rejetant un christianisme qui malgré son schisme et ses guerres de religion qui ensanglantèrent l’Europe pendant plus d’un siècle, a su faire avancer, graduellement, la dignité humaine – crédo ensuite récupéré par les philosophes des Lumières et les révolutionnaires français. Au tournant du 3e millénaire, les droits de l’homme ont été sacralisés en un absolu planétaire qui invite à un « impérialisme » mondialiste. Ce fourre-tout globaliste a mené à une masse de consommateurs déracinés et à une aristocratie pouvant les contrôler. L’intention derrière ce manège idéologique n’est pas le « bien commun » mais la somme d’intérêts particuliers plus facilement manipulables.
On répondra qu’un roi n’agissait qu’en fonction de ses intérêts personnels. En consultant attentivement les livres d’histoire, on y trouvera des rois troublés, dépressifs, épuisés, pour qui l’exercice du pouvoir devenait insupportable, n’y voyant là qu’une vie de sacrifices, une fatalité implacable, un devoir émanant de Dieu – Louis XIII et Louis XV incarnaient ces rois mélancoliques qui n’étaient d’abord pas destinés à régner, mais qu’une série d’événements allaient placer sur le trône. Une vie de luxe, certes, mais engourdie par le désespoir, la solitude, la peur de l’échec. Les rois français, sauf quelques rares exceptions, avaient à cœur le bien-être de leurs sujets et du royaume. Peut-on en dire autant des gouvernements actuels ? Se préoccupent-ils réellement des citoyens quand leur seul réflexe est de vouloir arracher puis conserver le pouvoir ? Les intérêts d’un roi s’alignaient, eux, à ceux du pays.
Si la censure et la répression politique seraient, semble-t-il, intimement liées aux régimes monarchistes passés, la démocratie libérale de notre époque n’a pas à se bomber le torse : le 21e siècle est celui d’une gauche mondialiste bien-pensante qui ostracise et musèle ses opposants. Il n’est pas rare qu’un libre-penseur de droite, nationaliste ou étiqueté de « complotiste » se fasse exclure de l’espace public pour avoir osé s’aventurer en-dehors des sentiers battus.
La liberté promise par la démocratie, fantasme intemporel, n’est plus qu’un attrape-nigaud démagogique. Nous sommes surveillés comme jamais ; nos mouvements sont épiés par la technologie, nos paroles et notre pensée soumises au diktat woke ; nous vivons sous des piles de règlements, de limitations, de codes moraux, de taxes, d’impôts ; les labyrinthes bureaucratiques s’intensifient. Si des mesures ou lois sont évidemment nécessaires dans le contexte historique québécois – pour sécuriser nos frontières, contrer notre anglicisation, protéger notre patrimoine bâti, etc. – la prééminence de l’État dans nos vies soulève des inquiétudes. Le délire covidien a ravivé, à lui seul, les craintes d’un monde orwellien à venir. L’électeur n’est plus qu’un individu automatisé, froid, déboussolé, sans repère identitaire. C’est un citoyen du monde pour qui ses origines n’ont plus aucune signification.
La démocratie emprunte au libéralisme ses imperfections et son imprécision. Elle condamne notre peuple à des luttes politiques stériles et futiles. Avec l’Acte constitutionnel de 1791, le Bas-Canada et le Haut-Canada accédaient à la première marche de la démocratie représentative – les rivalités politiques s’activaient. Les médias se sont joints à cet effort partisan. Au 19e siècle, plusieurs journaux, pamphlets et périodiques affichaient clairement leurs allégeances politiques. Cette démocratie si vigoureuse, enflammée, passionnée, celle qui a déjà propagé la circulation d’idées allant du conservatisme, au libéralisme, en passant par l’ultramontanisme et le laïcisme, nous déchira, nous divisa. Elle nous éloigna donc de notre objectif : doter les Canadiens français d’un État national.
Le citoyen a l’illusion d’être ancré profondément dans une démocratie qui, bien que défaillante, lui apparaît encore comme étant concrète et perfectible. Dans les faits, il n’en est rien. Il ne la contrôle plus. Elle a été détournée par les politiciens et les plus puissants. La démocratie ne tient pas sa promesse d’accorder une plus grande liberté économique et politique. Marcel Gauchet écrivait dans La crise du libéralisme « que la modernité et la démocratie divisent, séparent, opposent, délient et dispersent les individus ». Les premiers à élaborer une critique poussée de la démocratie furent, sans doute, les marxistes. La démocratie n’était pas à leurs yeux « le gouvernement du peuple par le peuple » mais visait plutôt à assurer la domination de la bourgeoisie sur le prolétariat. Cette interprétation léninienne servait de prétexte pour implanter une autre idéologie : le communisme.
En tentant de jouer aux libérateurs de peuples, certains gouvernements occidentaux, et l’intervention états-unienne en Irak en est un cas classique, abusèrent du mot « démocratie ». Le capitalisme sauvage aussi, en voulant s’implanter partout, en cherchant à établir un marché international et en souhaitant tout démocratiser (cannabis, transhumanisme, transgenrisme, etc.). Un capitalisme qui se moque du patrimoine bâti d’une ville, qui banalise le voile islamique, qui encourage l’immigration massive. Si les observations et les analyses du marxisme semblaient parfois justes et à-propos, ses solutions ne menaient, elles, qu’au communisme – avec ses millions de morts, sa pauvreté, sa cruauté, sa loi du silence, son abolition de la propriété privée.
En somme, si invoquer les failles de la démocratie peut être un exercice salutaire, la savoir (ou la croire) en crise perpétuelle peut avoir un double effet pervers : offrir à la gauche radicale une arme politique redoutable en présentant son idéologie comme étant un moyen sûr de soigner une société malade et en pavant la voie à des anarchistes qui seront trop heureux de participer à la déconstruction occidentale.
Les gouvernements, par la technologie et la bureaucratie, contribuèrent à affaiblir les liens sociaux, à nous déshumaniser, à nous enfermer tout un chacun dans une mentalité d’assiégé incapable de trouver un sens à sa vie. La société se définit désormais par une inauthenticité permanente où l’individu se perd dans une masse multiculturelle et mobile. Du reste, dans les démocraties libérales, la constitution prévoit habituellement des mécanismes pouvant suspendre les libertés et l’État de droit. « L’état d’urgence » décrété pendant la Covid-19 et la « Loi sur les mesures de guerre » ordonnée par le gouvernement Trudeau lors de la crise d’Octobre 70, témoignent de la facilité pour un chef d’État de s’octroyer les pleins pouvoirs. S’il peut y avoir éventuellement un prix politique à payer, le caractère liberticide d’un tel gouvernement se compare à celui des régimes totalitaires.
« Pour Carl Schmitt, l’État libéral, caractérisé par le parlementarisme, produit l’illusion que c’est la loi qui décide des règles. Or, Schmitt, dans son livre Théologie Politique, avance l’idée que quand une situation d’exception se présente, la loi et la justice ne peuvent décider rapidement de ce qu’il est bon de faire pour sauvegarder l’État. Seul le chef, le président, bref celui qui détient le pouvoir exécutif, est souverain véritablement pour dicter la marche à suivre. Cela signifie ni plus ni moins que le véritable pouvoir n’est pas celui du droit, de la démocratie ou de la justice, mais celui du chef, du pouvoir exécutif qui décide en dernière instance[ii]. »
La démocratie libérale abrutit les masses ouvrières, isole les gens et s’ajuste mal aux situations exceptionnelles. Elle devra vite retrouver ses repères et se réorganiser. Dans certaines circonstances, le Québec gagnerait en transparence, en respectabilité et en représentativité, s’il mettait en œuvre une démocratie plus directe − par le biais entre autres de référendums populaires. La démocratie déléguée, elle, fait plutôt élire des députés terriblement manipulables et partisans, au point d’aboutir à une sorte de détachement du citoyen quant à la politique et à une grogne quasi généralisée.
La principale mission qui guettera les pionniers d’un Québec indépendant sera la même qui attend toute nation nouvellement souveraine et libre : ériger son cadre constitutionnel et politique. Un défi qui alimentera assurément les passions. Nous voici à de la politique fiction. Il est impensable d’envisager qu’un pays comme le Québec puisse faire revivre une monarchie absolue qui reconnaîtrait comme chef d’État un monarque héréditaire. La démocratie est bien installée dans nos mœurs politiques. Elle pourra être remodelée selon nos besoins et nos aspirations.
Il n’y aura, hélas, aucune recette miracle. C’est « choisir la moins pire des solutions », diraient les plus cyniques. Des facteurs internes et externes influenceront les décideurs québécois de demain. Un peuple menacé et minoritaire comme le nôtre doit savoir s’adapter et compter sur un pouvoir exécutif fort et stable, sur un chef, un vrai, un leader capable d’affronter le gouvernement fédéral, le Canada anglais et les aléas qui peuvent miner notre épanouissement culturel, notre prospérité, notre confiance, notre courage, notre volonté collective à poursuivre l’aventure canadienne-française. Ce pouvoir musclé doit servir nos intérêts nationaux en s’employant de manière à perpétuer les éléments qui composent notre identité nationale – pour préserver notre langue, resserrer les frontières, réduire l’immigration, favoriser l’essor de notre culture – et non pas en suspendant des libertés sous des prétextes discutables, fallacieux, partisans ou strictement politiques, qu’il s’agisse d’une « crise » sanitaire ou d’une « crise » climatique.
[i] Le sociologue Fernand Dumont commentait ici le comportement disgracieux des membres du gouvernement Trudeau lors de la crise d’Octobre.
[ii] Extrait de l’article « La démocratie face à ses critiques au XXe siècle », publié sur revue-democratie.org.