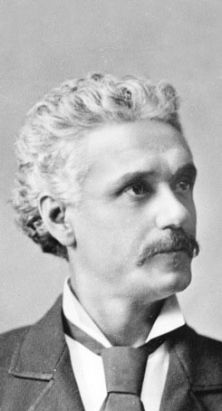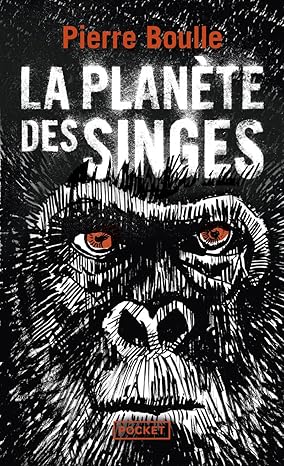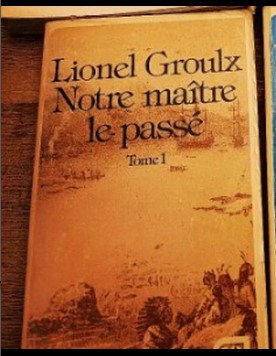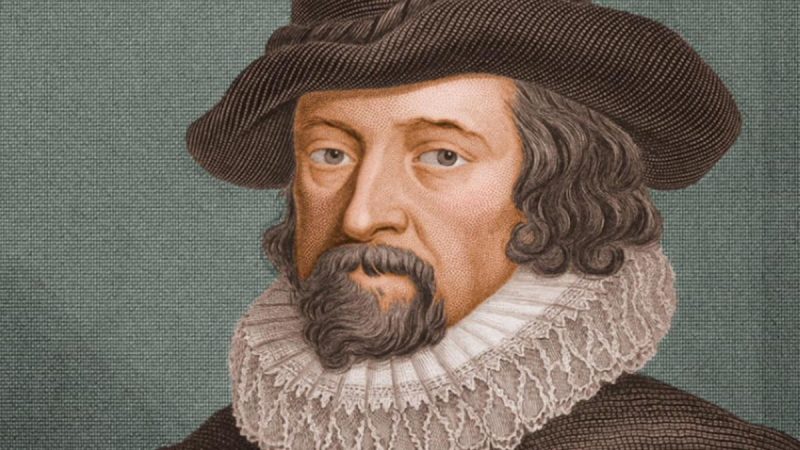« L’actualité occupe peut-être plus de place que l’histoire, mais aujourd’hui l’histoire est plus utile que jamais pour enrichir notre lecture de l’actualité ».
− La revue d’histoire du Québec Cap-aux-Diamants, Printemps 2005
Le mouvement de sécularisation qui a balayé le Québec dans les années 1960 a relégué la religion catholique à l’arrière-plan de la vie publique. Une laïcité décomplexée qui allait non seulement changer le visage d’un Québec pratiquant mais également s’en prendre à ses traditions et à ses symboles plus que centenaires. Notre nationalisme s’est graduellement vidé de sa base historique et culturelle. Le Québec de 2025, sans boussole spirituelle, a besoin de retrouver son esprit d’antan, sa propre identité historique, son instinct de survie. Nous, descendants des colons de la Nouvelle-France, avons un devoir de mémoire vis-à-vis ceux qui explorèrent, défrichèrent, labourèrent, défendirent et aimèrent ce sol qui a vu naître et grandir un peuple : les Canadiens français.
Le catholicisme fait partie de nous. Il nous a défini, il a su générer des hommes et des femmes d’un tempérament exceptionnel, perfectionner notre talent, garantir une moralité exemplaire, apposer sa signature architecturale le long des rives du majestueux fleuve St-Laurent. Le désavouer et le rejeter, c’est renoncer au passé, s’effacer, capituler, mourir.
RETROUVER UN SENS À NOTRE VIE COLLECTIVE

Pour faire contrepoids au postmodernisme et au mondialisme – alimenté par une gauche agressive qui fait table rase de l’histoire occidentale et par une droite déracinée dédiée au libéralisme économique et aux profits − les nationalistes canadiens-français doivent ramener, dans l’inconscient collectif, une forme d’orgueil national ou populaire, c’est-à-dire renouveler leur patriotisme. C’est en connaissant notre histoire et en embrassant nos origines que nous saurons rester debout, résister et nous épanouir. Il s’agit de s’intéresser à une histoire parsemée de luttes, de déceptions, de menaces d’assimilation, de dangers politiques − pour mieux comprendre notre évolution anthropologique, ne pas répéter les mêmes erreurs et apprécier les sacrifices des pionniers de la nation − d’héroïsme, de courage et de ténacité − pour se bomber le torse et s’insuffler une mégadose de patriotisme − par l’éducation, la lecture, l’étude de notre généalogie, la visite de musées, l’incursion dans notre culture d’essence française et gréco-romaine, la découverte de nos plus grandes œuvres artistiques. S’élever donc de manière à cultiver le culte du beau et de l’excellence, à s’attacher à notre patrimoine et à admirer notre paysage qui, peu importe la saison, a quelque chose à raconter, tend à nous émouvoir, à nous faire rêver – une flore diversifiée, une faune accessible, des champs infinis, l’immensité et la splendeur de forêts qui stimulèrent tant d’auteurs et de chansonniers, des cours d’eaux qui guidèrent nos coureurs des bois.
Les églises, les presbytères, l’art religieux, les reliques et les fêtes chrétiennes qui, encore aujourd’hui, tapissent le Québec, confirment que notre passé, loin d’être banal, s’inscrit dans une continuité historique. Nous pouvons nous réjouir de la richesse patrimoniale laissée par le catholicisme et être fiers de la piété de nos ancêtres. Tout Canadien français devrait emprunter le chemin de la « rédemption patriotique », celui qui le mènerait à travers le Québec, la francophonie canadienne et l’Acadie dans le but de fraterniser avec les siens, avec ses compatriotes. C’est se réapproprier notre histoire, s’imbiber de l’ambiance d’autres époques, lier le présent au passé, combler un vide affectif et psychologique, réfléchir à hier, s’imprégner du cœur et de l’âme de notre patrie bien-aimée. Puissante figure identitaire, le catholicisme incarne l’image de notre essor national. Sans lui, nous ne serions que de vulgaires nord-américains anglicisés. Si nous espérons poursuivre en français notre magnifique épopée en Amérique, nous devrons nous inquiéter de la voie empruntée par nos décideurs tout en déterrant notre histoire, nos valeurs, nos traditions, nos symboles, nos coutumes, bref ce qui fait de nous un peuple si unique, si original, si distinct. Il n’est pas question ici d’un retour à l’ultramontanisme, de croire en Dieu ou de prier comme des zélés, mais de redonner un sens à notre vie collective, de glorifier les bâtisseurs du Québec, de commémorer les nôtres.
Avec la laïcisation et la déconfessionnalisation de la société québécoise, accélérées entre autres par le concile Vatican II et le dogmatisme de la Révolution tranquille, c’est un pan de notre histoire qui devait peu à peu s’éteindre. Le 21e siècle, c’est celui du « confort et de l’indifférence » face à notre avenir, face à la désintégration de nos traditions, face à la dévastation de notre patrimoine bâti − des symptômes de maux qui frappent lourdement une identité fragilisée. Pendant que le mondialisme transforme le noyau démographique du Québec, le gauchisme dit woke facilite de son côté l’implantation d’une sorte de réingénierie sociale devenue incontrôlable.
Ne permettons pas aux idéologues fanatisés de réécrire une histoire du Québec qui ne débute pas avec les supposés bénéfices de la Révolution tranquille ni avec la Conquête britannique. Elle commence en Nouvelle-France pour ensuite traverser une ligne du temps dramatique qui abonde en défis politiques, linguistiques, économiques, sociaux et démographiques. Christian Rioux écrivait le 18 septembre 2010 dans Le Devoir :
« Les révolutionnaires tranquilles ont sculpté sur mesure le mythe de la Grande Noirceur. Le temps serait-il venu de s’en débarrasser ? (…) Représentant d’une nouvelle génération d’historiens soucieuse d’exercer son droit d’inventaire, Éric Bédard juge que “les libéraux des années 1960 ont noirci le tableau en accréditant la thèse d’un Québec moyenâgeux. Ces idées ont été véhiculées partout et relayées par beaucoup d’intellectuels. Ces gens étaient détestés par le régime Duplessis. Ils ont rendu à Duplessis la monnaie de sa pièce en accréditant la mythologie de la Grande Noirceur.”
Au Québec, chaque génération a tendance à se construire sur le rejet de la génération précédente. C’est un peu cela qui nous tue. La génération de la Révolution tranquille s’est entièrement construite sur le rejet de ce qui existait avant elle. Si tout ce qu’on avait fait avant 1960 était mauvais, si on était tellement attardés, abrutis et sous la domination de l’autoritarisme politique et religieux, comment après ça avoir confiance en soi pour construire un pays ? »
CONSTRUIRE L’ÉTAT NATIONAL DES CANADIENS FRANÇAIS

Si les révolutionnaires tranquilles ont pu mettre en place autrefois leurs réformes, ils le devaient d’abord à la construction minutieuse de l’État québécois par leurs prédécesseurs. La marche pour l’autonomie du Québec s’est amorcée en 1867 avec la mainmise du gouvernement québécois sur les principaux enjeux liés à notre survivance – l’éducation, les services sociaux, le droit civil. Les Québécois pouvaient dès lors se doter d’un État bien à eux malgré les pouvoirs reconnus au gouvernement fédéral : les frontières, le droit criminel, la monnaie, etc. Si le Québec doit toutefois se séparer d’un Canada toxique et postnational, l’axe référendaire est, lui, somme toute stérile voire suicidaire.
« Sur le plan extérieur, King continue la politique de Laurier et Borden. Il contribue à garder le Canada sur la voie de l’autonomie face à l’Angleterre. À la suite de l’adoption, en 1946, de la loi abandonnant la citoyenneté britannique, Mackenzie King a l’honneur de devenir le premier citoyen canadien en 1947[i]. »
Gagnons notre autonomie brique par brique à l’image du Canada auprès de Londres en introduisant des politiques structurantes et en s’appuyant sur les outils légaux et les leviers économiques déjà à notre disposition : diminuer l’apport du gouvernement fédéral dans l’administration des affaires courantes, promouvoir la décentralisation de l’État canadien, réclamer le respect des compétences dévolues au Québec, revendiquer plus de pouvoirs en immigration, avoir un recours systématique à la clause dérogatoire, maintenir une présence policière accrue aux frontières, nominer les juges de la Cour supérieure du Québec, instaurer unilatéralement une citoyenneté québécoise, élaborer une constitution québécoise soulignant notamment le fait français, nos assises catholiques et la notion de nation historique canadienne-française.
Le Québec est tenu de s’assumer sans gêne et sans complexe. Le premier ministre François Legault aurait dû profiter de la faiblesse politique des gouvernements minoritaires de Justin Trudeau ou de la pression exercée par la guerre commerciale trumpiste sur les politiciens canadiens pour attiser les divisions au sein de la confédération canadienne et pour poser des gestes autonomistes musclés, tangibles et durables. De plus, le moment n’aurait-il pas été opportun d’inclure dans les négociations sur Churchill Falls entre le Québec et Terre-Neuve le rapatriement du Labrador ? La situation géopolitique du Québec l’oblige à être proactif et à réagir dès que le gouvernement fédéral vit une crise, est instable politiquement ou tente de recouvrer l’équilibre budgétaire. Si Ottawa veut assainir les finances publiques, un gouvernement nationaliste le moindrement habile et ambitieux tenterait d’acquérir des propriétés fédérales situées sur le territoire québécois : infrastructures, ponts, parcs nationaux, sites historiques.
N’oublions pas que c’est à l’Assemblée nationale du Québec d’avoir le dernier mot sur les déterminants fondamentaux de notre existence. Pas Ottawa, ni Washington, ni l’ONU, ni autres patentes supranationales. Nous ne devons pas quêter notre autonomie : nous devons l’imposer!
UNE CLASSE POLITIQUE DÉCONNECTÉE

Avec le Parti québécois qui domine dans les sondages, l’idée d’un troisième référendum sur l’indépendance du Québec revient dans l’actualité – référendum qui n’aurait probablement aucune effectivité juridique ni reconnaissance internationale. La prochaine campagne électorale québécoise se dessine comme étant une éventuelle pièce de théâtre politique démodée mise en scène par des partis − PQ et PLQ − qui carburent au clivage entre souverainistes et fédéralistes. Si la perspective d’un Québec libre de ses choix séduit et que sa réalisation est souhaitable, la stratégie adoptée par les référendistes soulève, elle, des doutes et des malaises. Elle est basée sur une vision de type « social-démocrate » qui nous éloigne de la raison devant motiver nos efforts pour émanciper politiquement le Québec : celle de préserver la nation canadienne-française en insistant sur l’édification d’un État qui s’harmonisera avec ses traditions, sa langue et son héritage culturel. Un « indépendantisme de gauche » n’a qu’une saveur idéologique et ne soulève pas le même enthousiasme ni les mêmes passions et émotions qu’un indépendantisme tiré de l’évolution normale de notre peuple. L’indépendance du Québec n’a rien d’un projet de société politisé; elle évoque un idéal modelé sur notre volonté d’exister, sur une lutte qui dure depuis des siècles et qui verrait, dans son accomplissement, une conclusion logique. Nos aspirations indépendantistes doivent transcender les orientations particulières de la société.
Il ne faut pas croire que la remontée péquiste dans les intentions de vote soit associée à de la nostalgie politique ou à une envie soudaine des Québécois pour la souveraineté. L’usure caquiste se sent dans la population et le PQ est, par défaut, une option envisageable. Vouloir réaliser l’indépendance pour s’opposer au pétrole albertain, multiplier les programmes sociaux et les « avancées » progressistes ou détenir un siège à l’ONU ne fait que décrédibiliser un courant politique légitime. Derrière la promotion de l’indépendance se cache souvent une gauche qui accumule les contradictions et pour qui l’aboutissement de la social-démocratie l’emporte sur tout. Un camp du « Oui » formé de Paul St-Pierre Plamondon, Yves-François Blanchet et de l’extrême-gauche solidaire effrayera les indécis et les souverainistes plus conservateurs. Le Bloc québécois est un parti gauchiste et mondialiste sans conviction nationaliste claire et ferme : Trudeau n’a-t-il pas constamment empiété sur les compétences du Québec et accentué le pouvoir d’instances fédérales − lancement d’un régime canadien de soins dentaires, d’un programme national d’alimentation scolaire et d’un régime d’assurance médicaments; préparation du projet de loi C-63 sur les préjudices en ligne – sans qu’il intervienne ? Un Bloc qui collaborait avec un gouvernement antipathique aux intérêts du Québec. Quant à Québec solidaire, ses principes socialistes et tiers-mondistes sont tout simplement incompatibles avec le nationalisme canadien-français.
Une victoire référendaire, aussi miraculeuse qu’elle puisse l’être, impliquera l’union franche et totale des Canadiens français du Québec et non l’exclusion et l’ostracisation de ses branches identitaires et conservatrices. C’est la seule alternative possible. D’où l’importance d’entretenir notre mémoire collective et d’admettre que nous formons une nation à part entière. Les musées à caractère identitaire, les archives et les objets patrimoniaux, le patrimoine immobilier et immatériel, la culture, les arts et le terroir renforcent une cohésion sociale si essentielle à la pérennité d’un peuple isolé − autrement dit, ils nous définissent, nous unissent, nous coalisent, enflamment notre amour-propre. Voilà le potentiel réunificateur que peut répandre notre histoire nationale si, sans l’instrumentaliser politiquement ni la juger à l’aune des valeurs actuelles, elle est enseignée et valorisée comme elle se doit. C’est la transmission, de génération en génération, de notre appartenance à la civilisation occidentale et à la nation canadienne-française. Sans cette identification ethnoculturelle, nous courons à notre perte puisque nous ne pourrons plus faire obstacle à la déshumanisation de nos comportements sociaux, à l’influence états-unienne et aux bouleversements démographiques qui s’opèrent sous nos yeux.
L’hégémonie mondialiste expose à nouveau notre angoisse existentielle. Ne confondons pas l’ouverture à l’autre avec le reniement de soi : une leçon que nos politiciens ne comprennent visiblement pas. « Le crucifix [de l’hôtel de ville de Québec] pourrait contrevenir à la laïcité de l’État, selon le gouvernement Legault », titrait le Journal de Québec du 18 décembre 2024. Désormais la laïcité québécoise, présumé remède contre toute dérive religieuse, met sur un pied d’égalité le catholicisme et les autres croyances et ce, même si le catholicisme a toujours été au centre de notre identité; qu’il a parrainé de superbes missions apostoliques; qu’une vocation pieuse teintée de mysticisme explique la fondation de Montréal; qu’il a solidifié nos liens familiaux et nos mœurs; qu’il se consacra à l’éducation de la jeunesse et de la future élite religieuse et intellectuelle canadienne-française; que le clergé, gardien de nos traditions, a créé de nombreux organismes communautaires; que les églises sillonnent le ciel québécois depuis plus de 400 ans et servent de point de repère visuel et spirituel. En résumé, l’Église a été rassembleuse et bienfaitrice, un catalyseur culturel, une mère sévère mais attentive et réconfortante. Renier notre patrimoine catholique contribue à susciter chez nous une impression de dépossession potentiellement irréversible.
UN RENOUVEAU NATIONALISTE

Si les Québécois apparaissent dorénavant léthargiques, s’ils semblent insensibles à leur louisianisation, ils le doivent à la faillite morale du capitalisme sauvage, à un gauchisme laïcard trop revanchard, à l’industrialisation qui libéra et intensifia les échanges commerciaux entre les pays, à une classe politique partisane et surtout à un mondialisme – phénomène issu de la philosophie humaniste qui se radicalisera au lendemain de la Seconde Guerre mondiale – menant à la dénaturation des sociétés de souche européenne. Nous vivons à une période marquée par la mondialisation, la technologie, l’individualisme, le matérialisme et la superficialité. C’est être à la solde d’oligarques qui se félicitent de nos habitudes hédonistes. La majorité historique québécoise, athée et sans guide spirituel, est en train de perdre ce petit quelque chose qui faisait d’elle une nation si solidaire, si tenace.
Pour inverser la tendance actuelle, il faudra davantage que des paroles politiciennes électoralistes, des concepts imprécis et des lois purement esthétiques susceptibles d’être édulcorées ou abrogées par un gouvernement ultérieur : travaillons à se réemparer de notre passé, de nos bâtiments patrimoniaux, de nos personnages et lieux historiques, de notre culture, afin que le nationalisme canadien-français coule dans nos veines et pénètre dans nos poumons; pour qu’il redevienne un réflexe inconditionnel, un automatisme quotidien, notre façon d’agir et d’être. Canalisons nos forces à retrouver ce sentiment national si naturel plutôt que de s’entredéchirer sur des sujets secondaires ou un processus référendaire qui, en cas d’échec, se traduira par une désillusion définitive sur notre capacité à croire en nous, à se gérer nous-même, à se soustraire de notre défaitisme chronique. Personne ne nous viendra en aide.
Ceux qui fantasment sur l’annexion du Canada ou du Québec à son voisin états-unien se trompent évidemment de cible : cette hypothèse politique a repris récemment de la vigueur avec les propos sarcastiques de Donald Trump. Si un jour ce scénario devait se concrétiser, il en serait fini, en une ou deux générations, du Québec tel que nous le voyons en 2025. Un gouvernement fédéral dirigé par Pierre Poilievre n’aurait pas non plus amélioré notre sort. Le Parti conservateur du Canada se focalise presque exclusivement sur les enjeux économiques et la diffusion de slogans insignifiants. Un gouvernement conservateur à Ottawa ressemblera aux gouvernements conservateurs britanniques de 2015 à 2024 ou à ceux de l’Alberta et de l’Ontario. Les politiciens de « droite » à la Doug Ford ne sont que des libéraux classiques, des néoconservateurs à la sauce progressiste et mondialiste qui fuient les vraies valeurs conservatrices. L’état lamentable de l’Angleterre après les années conservatrices le démontre assez clairement. Un État ne se résume pas au PIB, au taux d’inflation ou à la croissance économique. Sans minimiser l’incidence de l’économie dans le développement d’un pays ou dans la réorganisation des services publics, nos dirigeants auront à prioriser la démographie et le rétablissement d’un patriotisme canadien-français. Une économie en santé n’est utile pour nous, nationalistes, que si elle peut redynamiser un patriotisme alors en mesure de s’immiscer efficacement dans des domaines comme l’éducation, la culture et le patrimoine.
Faire du Québec le foyer national des Canadiens français exige une action citoyenne et politique qui démarre inévitablement par un hommage franc et une loyauté indéfectible aux legs de nos ancêtres. Un passé certes imparfait, néanmoins sincère, qui a conduit à notre enracinement en Amérique du Nord. C’est remonter le temps en faisant le plein de lieux patrimoniaux qui nous ramènent là où notre histoire remarquable s’est écrite; c’est arpenter le Québec pour s’abreuver des endroits significatifs de notre histoire, en imitant nos aïeux qui, dans une ferveur religieuse, parcouraient le Québec à la recherche du salut éternel. Ils foulaient ainsi les plus célèbres sanctuaires d’ici en les nourrissant de leurs prières et de leurs espérances. Et si nous nous inspirions de ces manifestations humaines jadis religieuses pour reconquérir notre « moi » collectif, pour se souvenir de qui nous sommes. Pourquoi voyager à l’autre bout du monde quand le Québec regorge de trésors architecturaux, de monuments historiques, de sites patrimoniaux spectaculaires, de paysages à couper le souffle et d’une culture à toute épreuve ?
[i] Denis MESSIER, La revue d’histoire du Québec Cap-aux-Diamants, Printemps 1994, p. 58.