La pauvreté n’est pas un nouvel enjeu : il est là depuis toujours. Que faire pour améliorer le sort de ceux qui en arrachent vraiment ? Les solutions sont nombreuses mais elles peuvent aller dans un sens comme dans l’autre. On s’y perd!
À la page 25 de son rapport « Une cible à atteindre pour le bien de tous : Une cible atteignable si l’on s’y met tous », le Comité consultatif de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale (CCLP) propose l’instauration d’un fond d’indemnisation qui pourrait venir en aide aux personnes en situation de pauvreté ou à celles qui n’ont tout simplement pas les moyens de souscrire une assurance habitation dite « assurance locataire ou logement » (1). L‘organisme a fait cette recommandation en marge d’un plan d’action gouvernemental en matière de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale.
« Il est possible d’associer les assureurs au financement d’un tel fond qui représenterait leur contribution à la lutte contre la pauvreté, écrivait-il. Ils pourraient même y trouver leur compte car en effet, leur pratiques tarifaires laissent à penser qu’ils ne souhaitent pas vraiment assurer les personnes à faibles revenus. »
Cette proposition mène à un grand débat de société qui pourrait aussi englober l’idée d’obliger un locataire, peu importe ses moyens financiers, à souscrire une assurance locataire. La situation financière et l’occupation d’un individu peuvent influencer la prime ou tout simplement l’acceptation ou non d’une demande d’assurance. Chaque assureur a ses propres critères et ses propres normes à respecter : une compagnie peut refuser d’assurer quelqu’un sans emploi ou sans crédit favorable. Face au peu d’assureurs prêts à lui faire une soumission, le locataire se retrouvera donc avec seulement quelques propositions tous des plus insoutenables et déraisonnables. Le locataire, frustré et résigné, décidera peut-être de « s’autoassurer ». Autrement dit, il ne s’assurera nulle part.
Au Québec, nous retrouvons en assurance automobile un mécanisme rigoureux mais fiable qui permet aux automobilistes de s’assurer minimalement auprès d’une compagnie d’assurance de dommages. Il serait logique d’envisager quelque chose de similaire pour les locataires se retrouvant sans assurance.
L’exemple de l’assurance automobile
Les assureurs devraient non pas contribuer à un fond d’indemnisation mais bien à un organisme qui viendrait leur ajouter une forme de canal de réassurance supplémentaire qui pourrait se comparer au Plan de répartition des risques automobiles (PRR) (du Québec) ou à la Facility Association implantée dans certaines provinces canadiennes.
En bref, un assureur sélectionnera une partie de son volume de primes liée aux dossiers les moins intéressants pour ensuite la céder au PRR qui prendra en charge le paiement des réclamations en proportion de ce qui lui a été soumis – en retour le PRR reçoit de l’assureur un pourcentage des primes annuelles perçues. L’assureur demeure par conséquence l’administrateur du contrat d’assurance : il règlera tout sinistre, toute modification, etc. Le client peut ainsi assurer sa voiture plus facilement (et obtenir l’assurance minimale obligatoire en vertu de la Loi sur l’assurance automobile) tandis que le risque est partagé entre l’assureur et le PRR ; ce processus libère l’assureur d’un poids financier et permet des relations d’affaires plus saines. C’est un compromis acceptable qui, même s’il se fait sans que l’assuré en connaisse les rouages ni même l’existence, repose sur un cadre efficace, légal et reconnu.
En d’autres mots, le PRR (ou la FA) est un réassureur, un assureur de dernier recours pour les cas plus problématiques – pensons par exemple à une fréquence de sinistres, à des antécédents criminels, à des annulations pour non-paiement de prime, à un véhicule ciblé pour le vol sans dispositif antivol, au transport de marchandises dangereuses – qui présentent un risque plus élevé que la moyenne. C’est un peu comme si les assureurs assumaient collectivement certains risques. Tous y gagnent : le consommateur souscrit une assurance et peut donc circuler légalement sur la route avec son véhicule, l’assureur fait des affaires selon ses propres critères et l’industrie de l’assurance répond aux besoins des gens en se partageant équitablement les primes et les indemnités à payer.
Il ne s’agit pas ici de décrire le fonctionnement détaillé du PRR ni d’expliquer l’ABC de l’assurance automobile mais bien de démarrer un débat sur les solutions pouvant améliorer l’accès des consommateurs au marché de l’assurance habitation et de démontrer brièvement pourquoi l’idée d’un fond, quoique initialement prometteuse, n’est ni réaliste ni pratique…et qu’il serait plutôt souhaitable de venir copier le principe derrière le PRR pour permettre à un locataire d’avoir accès au moins à une assurance habitation de base. N’est-il pas illogique que ce soit l’assurance auto et non l’assurance habitation qui bénéficie d’abord d’un système bien huilé et somme toute « avant-gardiste ? Pouvoir se loger et protéger son patrimoine n’ont-ils pas plus d’importances que de se promener en voiture ?
Les avantages d’avoir une assurance versus un fond
Pour le consommateur mais aussi pour la société elle-même, suite à un sinistre, détenir une assurance habitation est de loin préférable à devoir se fier à un fond d’indemnisation. D’abord lorsque nous faisons affaires avec un assureur, nous traitons avec un agent en assurance de dommages qualifié et certifié – ce sont des professionnels de l’assurance capables de bien identifier les besoins et les risques associés à un client. Ils sont donc en mesure de conseiller le consommateur sur les produits disponibles et sur les mesures préventives à prendre pour réduire les probabilités d’un sinistre majeur ou d’une fréquence de sinistres – la prévention joue un rôle central dans l’industrie de l’assurance de dommages. Le règlement d’un sinistre est aussi facilité par le travail d’un expert en sinistre lui aussi certifié qui saura rassurer, guider et accompagner l’assuré.
Un consommateur sans assurance qui se fierait seulement à un potentiel fond pour l’indemniser aura peut-être l’habitude de négliger l’entretien de son appartement ou de prendre des risques inutiles – il est prouvé que la négligence correspond bien souvent à un « risque moral » et occasionne plus d’incidents. Évidemment pour pouvoir bénéficier d’un fond, un individu devra répondre à certains critères car il serait inconcevable qu’un tel fond ressemble à un bar ouvert sujet à bien des abus. Comme avec l’assurance-chômage si on peut oser cette comparaison.
Et qui financerait le fond ? Les assureurs (qui en profiteront sans doute pour augmenter les primes des autres en contrepartie) ? Le gouvernement québécois ? Les contribuables au moyen d’une nouvelle taxe ou d’une nouvelle cotisation spéciale ? D’une contribution d’assurance additionnelle ? A partir de la taxe des primes d’assurance (9%) ? Qui le renflouera s’il est déficitaire ? Devrait-il être autorisé et surveillé par l’Autorité des marchés financiers (AMF) ? Le beau casse-tête!
Comment déterminer les barèmes qui donneront accès au fond ? Qui les détermineront ? Seront-ils biaisés ? Qui va gérer le fond ? Est-ce que sa gestion serait apolitique ? Est-ce que le gouvernement pourrait y nommer les amis du parti ? Qui va gérer les demandes d’indemnités ? Qui est sera responsable ? Est-ce que l’État pourrait venir piger dedans pour renflouer ses coffres ? Servirait-il de levier politique ou économique ? Qui réglera les conflits et les litiges ? Est-ce que l’État interviendra encore dans nos vies ?
Un fond qui deviendrait difficile à gérer
La tranquillité d’esprit n’a pas de prix : savoir que l’on pourra compter sur les service d’un assureur doté d’un code de déontologie et d’obligations légales (Code civil, Loi sur les assurances, etc. ) si un pépin survenait. La gestion d’un fond comporte lui-même d’énormes risques financiers, de malversation, d’incompétence, d’indemnités arbitraires, etc. Ce n’est pas à un gestionnaire de fonds à la sauce « fonds de retraites » ni à un organisme parapublic ou gouvernemental de gérer des programmes d’assurance. Laissons l’assurance aux assureurs – le gouvernement n’a qu’à encadrer de manière générale, comme il le fait actuellement, les relations contractuelles, les droits des consommateurs et les paramètres minimales d’une éventuelle assurance locataire obligatoire (pour obliger les locataires à s’assurer dans un exercice similaire à l’assurance auto).
L’assurance locataire obligatoire devient une solution beaucoup plus réfléchie, terre à terre et pragmatique. Elle réglerait bien des problèmes et des tracas. Mais voilà un enjeu pour un autre jour!
L’injustice potentielle d’un fond
Une police d’assurance est un contrat conclu entre l’assureur et l’assuré : des dispositions légales et contractuelles viennent lier les parties. Le Code civil du Québec vient déjà réglementer le tout. Pourrait-on mettre à jour certains articles ? Absolument! Mais créer un fond amènerait, nous venons de le voir, des interrogations, de l’incertitude et surtout une longue période de rodage et d’adaptation.
L’idée d’un fond comme mesure sociale est davantage politique et idéologique : l’État, l’État et toujours l’État, c’est le règne de la social-démocratie qui atteint néanmoins ses limites. Un fond pourrait inciter plusieurs consommateurs à annuler leur assurance locataire, pour donc ne plus à avoir payer de prime et dans l’espoir fondé ou non d’avoir droit à une indemnité facile. Le consommateur n’aurait-il alors pas l’impression voire l’illusion d’être bien assuré alors que dans les faits, la mise en place d’un tel fond relève d’une bureaucratie froide et austère plutôt que d’un assureur aux multiples services : estimation des dommages et de la cause du sinistre, liste de fournisseurs accrédités, travaux effectués par des professionnels, subrogation contre le tiers responsable s’il y a lieu, la possibilité du paiement de frais de subsistance si la garantie est présente sur le contrat, un service plus rapide qu’un fond géré par le gouvernement lors de catastrophes naturelles, etc.
Un fond, c’est encourager en quelque sorte une forme de dépendance vis-à-vis des mesures sociales qui peuvent parfois être peu contraignantes. Où est la justice lorsque des familles de la classe moyenne qui travaillent forts et qui souhaitent adéquatement assurer leur logement ou leurs biens paient une prime qui viendra amputer leur budget familial alors que d’autres sans assurance – par choix, par paresse ou insouciance – pourraient venir piger dans le plat à bonbons ?
1- Le rapport date de décembre 2009 et se retrouve au :
http://www.cclp.gouv.qc.ca/publications/pdf/cclp_avis_2010_cible_atteindre.pd








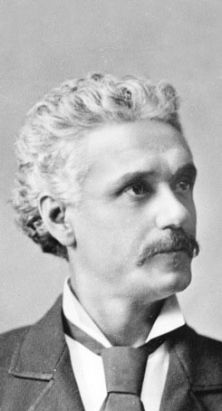
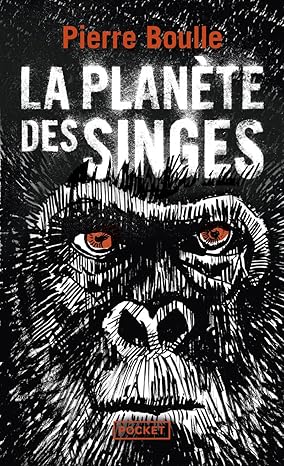


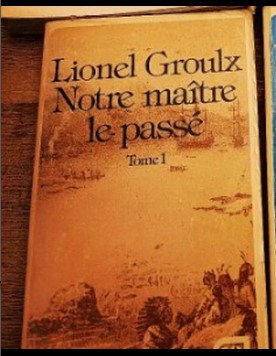
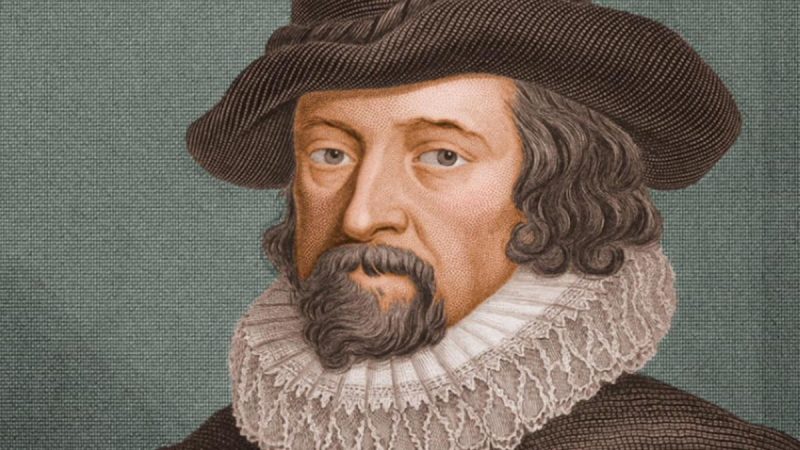



2 Responses
C est un veritable plaisir passez a lire ce billet, je vous remercie grandement !!!
Merci du commentaire!