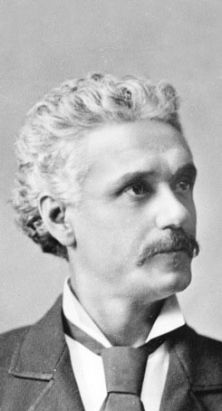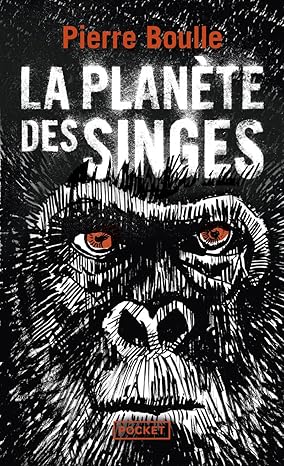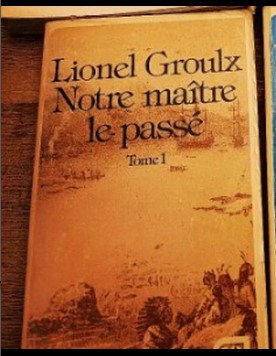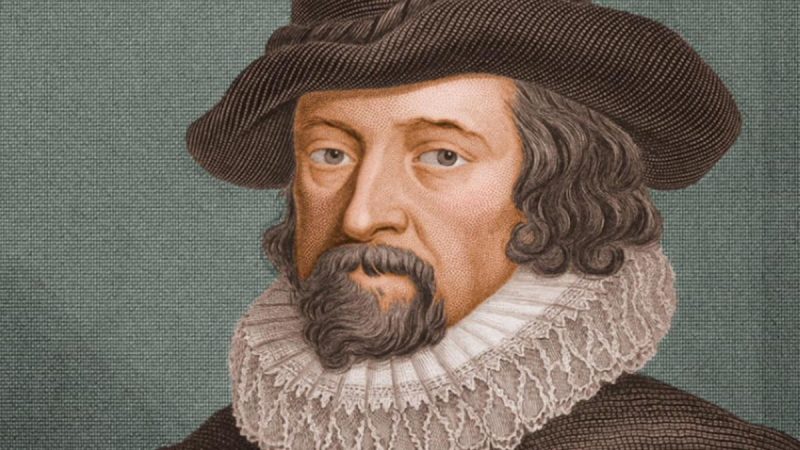J’ai un aveu à vous faire : je déteste voir des graffitis. Les graffitis symbolisent d’une certaine façon la laideur dont se drape maintenant la ville occidentale typique. Le mondialisme a certes changé notre visage démographique et le gauchisme des dernières décennies a évidemment amené une forme de laxisme généralisé. La gauche au pouvoir n’apporte dans les faits rien de très réjouissant. Ou si peu. La beauté de nos rues ne semblent plus être une priorité pour une classe politique sans doute trop occupée à exercer leur partisanerie et à faire avancer leur carrière.
Le vandalisme n’est pas un phénomène nouveau et il n’est pas limité aux métropoles comme New York, Montréal, Toronto ou Paris. Il se voit aussi chez nous, à Québec, ville supposément patrimoniale et historique, ville qui est le berceau de l’Amérique française, ville touristique par excellence. Nos politiciens se félicitent tous d’avoir contribués à cette image de marque mais ils ne parlent jamais de sa malpropreté chronique, de la dégradation de son tissu urbain, de la dévastation de notre patrimoine bâti pourtant à la base même de l’identité de notre vieille ville. Si nous voulons que Québec garde sa réputation de ville charmante et agréable, nos élus doivent d’abord s’intéresser à son apparence. Je ne parle pas ici des quartiers populaires de la Basse-ville mais bel et bien de son cœur historique, c’est-à-dire de la Haute-ville, de la colline parlementaire et du Vieux-Québec. Québec n’est pas Montréal, il va de soi, mais ce laisser-aller a de quoi nous alarmer.
Québec a un problème de graffitis et de vandalisme. Ces fléaux caractérisent aussi les autres grandes villes touristiques, mais bien souvent, ils se limitent aux quartiers plus éloignés, aux ghettos, aux bouches de métro, aux immeubles abandonnés enfin bref à l’extérieur du cadre touristique. J’ai assez voyagé pour le constater. Et Québec semble être une exception. Je ne dis pas que notre ville pullule en graffitis et n’offre plus qu’un visage hideux aux visiteurs et à ses citoyens, bien au contraire, je lance plutôt un appel à la vigilance et au gros bon sens. Nos décideurs doivent simplement se réveiller et ne pas jouer à l’autruche. Cet enjeu n’est pas anecdotique et sujet à plaisanteries. Il touche l’ABC même de la ville. Êtes-vous passé récemment par la Côte d’Abraham ? Ou par la rue St-Jean ? Les exemples de délabrement et de graffitis à l’infini ne manquent pas.
Je suis un amoureux d’histoire et de patrimoine et avec les années, j’ai développé un gout raffiné pour la beauté des paysages et des décors urbains. Rendons ses lettres de noblesse à notre ville qui a en grandement besoin et qui est, malgré tout, encore très belle.
Alors que faire. Par où commencer ? Il faut d’abord retrouver ce sentiment de fierté qui nous a malheureusement échappé avec les années. Il s’agit ici d’une forme de patriotisme qui n’existe aujourd’hui presque plus. La société actuelle, plus mondialiste, plus individualiste, plus terne, néglige son devoir de mémoire vis-à-vis son passé et de ses ancêtres et reste indifférente voire insensible devant la destruction de son patrimoine. Les citoyens doivent être plus attentifs à leur environnement immédiat et renouveler cette flamme nationaliste perdue quelque part entre la révolution tranquille et 2015. Un peuple qui se bombe le torse ne laissera pas sa ville, et encore moins sa capitale nationale, devenir un taudis ou être la cible de vandales criminogènes. La volonté politique, si nécessaire pour réussir à changer de cap, se pointera le bout du nez si les citoyens le crient haut et fort.
Les forces policières ont également un rôle à jouer, de même que nos élus qui par leur poste stratégique, peuvent intervenir avec des solutions tangibles (plus d’escouades de nettoyage à la Graff’Cité, l’ajout de policiers, un budget à la hausse pour certains intervenants, etc.), voter des règlements ou des lois qui viendront punir plus sévèrement les fautifs (par des amendes plus importantes, des travaux communautaires, des peines de prison, etc.) et encadrer plus efficacement le travail des policiers et des autorités municipales. La prévention devient un incontournable (des caméras aux endroits chauds, des messages pour sensibiliser la population).
Le législateur n’aurait pas, en principe, à rajouter d’autres lois et règlements : ceux en place suffisent. Il s’agit surtout de les appliquer plus vigoureusement et de porter une attention particulière aux amendes. A Québec, des règlements existent (avec entre autres l’article 14 et le Chapitre IV du Règlement sur la paix et le bon ordre). Puis, selon l’article 430 du Code criminel du Canada :
430. Commet un méfait quiconque volontairement, selon le cas :
- détruit ou détériore un bien ;
- rend un bien dangereux, inutile, inopérant ou inefficace ;
- empêche, interrompt ou gêne une personne dans l’emploi, la jouissance ou l’exploitation légitime d’un bien
Une peine d’emprisonnement maximale de deux ans est-elle dissuasive ? Le débat est lancé. Si pour épingler un vandale, la présence de caméras devient un outil intéressant, on ne peut pas passer sous silence l’enjeu de l’atteinte à la vie privée (intrusion). Souhaitons-nous vraiment un monde à la Big Brother du roman 1984 ? La multiplication des caméras peut effectivement faire peur. Avec l’insécurité qui s’installe comme jamais dans nos villes, la loi et l’ordre deviennent, dans un sens, essentiels. Mais où placer la ligne ? Bonne question. Le droit à la vie privée est notamment protégé par divers articles (5 et 9.1) de la Charte des droits et libertés de la personne et par le Code civil du Québec (articles 3, 4 et 36). Les tribunaux ont reconnus qu’il était possible, dans certaines circonstances, d’avoir recours à la vidéosurveillance : si elle répond à des motifs légitimes. Les villes peuvent donc envisager cette option si en contrepartie, elles se basent sur des balises claires.
Le journaliste Pierre Trudel analysait d’ailleurs, le 21 février 2014, l’usage des caméras de surveillance : http://www.journaldemontreal.com/2014/02/21/cameras-de-surveillance-que-dit-la-loi
Le vandalisme est un fléau qui en plus de dénaturer une ville, coûte cher. Pour une ville c’est le nettoyage et les mesures préventives ; pour un assureur, ce sont des sinistres à payer ; pour le citoyen, c’est une prime d’assurance qui augmente et la valeur de sa propriété qui diminue. Personne n’en ressort gagnant.
Nous devons retrousser nos manches et agir. Les graffitis deviennent une pollution visuelle. Son manque d’esthétisme altère notre qualité de vie. Les autorités doivent se ressaisir et voir la chose sous un angle nouveau.
La beauté de notre ville n’a pas de prix!