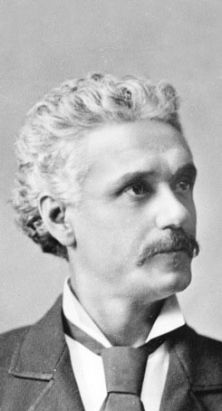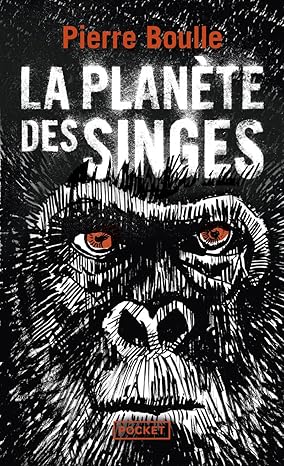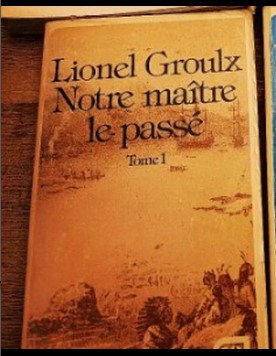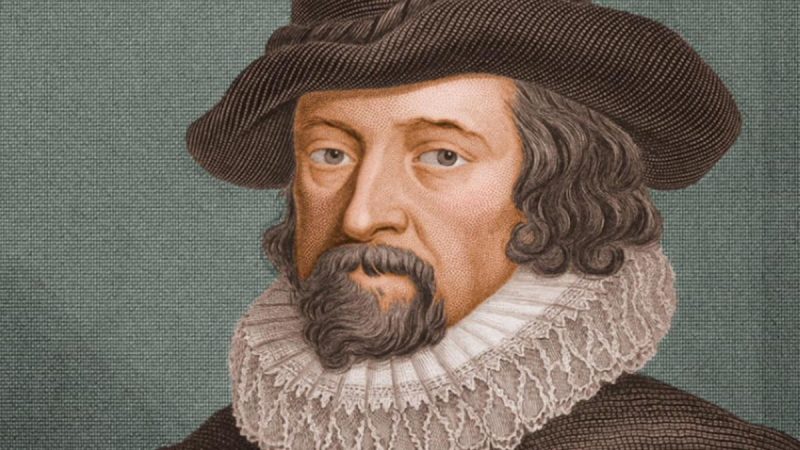« On est rendu dans le mur, ç’a toujours été des demi-mesures. C’est un vrai sujet. Ce n’est pas juste une question de collectionneurs ».
– Dinu Bumbaru, d’Héritage Montréal, à propos de l’abandon des églises du Québec.
Le mondialisme impacte de bien des manières le Québec. Toujours négativement. L’immigration de masse, son arme favorite, transforme le visage de nos villes, bouleverse notre démographie. Le rapport de force des Québécois de souche européenne s’amenuise de jour en jour. Le multiculturalisme, qui est la doctrine officielle de l’état canadien, n’impose aucune intégration aux nouveaux arrivants, bien au contraire.
Les sphères de la société ont tous été contaminées par la propagande mondialiste : éducation, médias, classe politique, institutions publiques, entreprises privées, les arts, etc. La gauche, devenue dans bien des cas, régressive, et la droite dite libérale, celle qui est déracinée au nom du PIB, font front commun dans une alliance inédite. La rectitude politique se présente maintenant comme une nouvelle norme sociale. Les nationalistes identitaires sont censurés, ostracisés, pointés du doigts. Ils s’autocensurent parfois eux-mêmes : une étiquette de raciste est si vite arrivée.
Les mondialistes font des appels répétés à la diversité et à l’inclusion. Ils veulent changer la société, ils espèrent une société ghettoïsée où chaque communauté vivra selon ses propres règles – chacune d’elle n’a donc pas à embrasser la culture et les traditions de la société d’accueil. Pour les mondialistes, nous devons faire table rase des symboles d’une civilisation occidentale qui serait à la source de bien des maux – imaginaires. C’est pourquoi ils se sont d’abord attaqués à la religion catholique. En somme, l’homme blanc serait de trop. Si certains pays résistent, les autres se laissent guider par une gauche mondialiste militante et fanatisée. Le Québec est à mi-chemin : il est isolé dans un Canada postnational qui considère le multiculturalisme comme étant un idéal et qui applique cette doctrine politique de manière agressive. Les Canadiens français deviennent ainsi une minorité parmi tant d’autres. Qu’ils soient le peuple fondateur n’a aucune importance. Si le Canada anglais se laisse remplacé avec naïveté, les Québécois eux se sentent différents : leurs racines françaises et catholiques traduisent cette unicité nord-américaine. Ils ont toujours eu à l’intérieur d’eux une fibre patriotique liée sans doute à leurs luttes pour contrer le conquérant britannique (et ses menaces d’assimilation). C’était la survivance dans son état le plus pur. Et 2019 ne fait pas exception. Les mondialistes cherchent donc à annihiler le nationalisme québécois ou canadien-français, à faire du Québec une terre multiethnique sans saveur, sans âme collective, sans noyau commun. Ils cherchent à éliminer une à une nos traditions, notre culture, notre histoire…notre identité. Notre identité se présente sous diverses facettes : notre langue, nos valeurs, notre ethnicité, notre terroir, nos coutumes, notre passé catholique, notre nordicité. L’histoire définit qui nous sommes en tant que peuple. Celle-ci peut être racontée mais aussi admirée – c’est ici qu’intervient notre patrimoine bâti.
Notre patrimoine est en danger
Le Québec a une relation intrigante avec son passé. Les Québécois s’identifient comme étant, c’est vrai, une société distincte ; on l’a vu par exemples avec les négociations constitutionnelles et par la modeste loi 21 du gouvernement caquiste. Mais ils n’affichent plus vraiment, et ce depuis la défaite référendaire de 1995 (la progression du mondialisme remplaçiste y est pour quelque chose) leur fibre patriotique. Ils la cachent, il s’en éloignent, ils la mettent de côté. C’est aussi leur fierté qui en prend un coup car de plus en plus ils restent indifférents voire insensibles aux phénomènes qui secouent la nation : son anglicisation, son insécurité, son endettement, sa pauvreté relative, son manque d’ambition, sa dépendance à l’État, les échecs du modèle québécois, la dégradation de son patrimoine, etc. Le Québec manque cruellement de patriotes. Un devoir de mémoire s’impose mais il se fait aujourd’hui bien discret. Est-ce que c’est cet état pusillanime qui amène les Québécois à négliger les témoins du passé, ceux qui retracent notre histoire, qui incarnent la beauté et la richesse culturelle de notre nation ?
Récemment, l’actualité a abordé les enjeux liés à la conservation et à la mise en valeur de notre patrimoine et de tout particulièrement, de nos maisons ancestrales. Des articles ont montré un patrimoine religieux en piètre état. Le Journal de Québec publiait, un août dernier, des statistiques alarmantes : des églises en ruine, d’autres tout simplement démolies, des barricades partout, des graffitis sur les murs. De l’indifférence, de l’immobilisme et un laisser-aller chronique. Il y a certes des églises qui ont eu la chance d’avoir un second souffle par une reconversion quelconque. Mais la réalité a frappée : notre patrimoine se meurt.
« Une recension effectuée en mai dernier par le Conseil du patrimoine religieux a révélé que 612 des 2746 églises qui avaient été répertoriées au Québec en 2003 avaient depuis été démolies, fermées ou recyclées [1] ».
À qui incombe la responsabilité de cette déconfiture patrimoniale ? Qu’ont fait les politiciens ? Qu’elle stratégie adopter à partir de maintenant ? Action Patrimoine (AP), un organisme à but non lucratif qui œuvre à protéger, à mettre en valeur et à faire connaître le patrimoine bâti et les paysages culturels du Québec, a tenté, avec quelques articles dans le magazine Continuité, d’y répondre. AP rappelle tout d’abord le rôle fondamental que peut jouer les propriétaires d’une maison ancienne ou d’un immeuble patrimonial. Posséder une maison ancestrale constitue pour plusieurs un rêve, notamment pour les amoureux de patrimoine. Mais qu’en est-il réellement au quotidien ? Quels sont les défis à relever ?
« Action patrimoine est le propriétaire de la maison Henry-Stuart située à Québec. Au fil du temps, l’organisme a eu l’occasion de découvrir les implications d’une telle responsabilité et de tirer quelques leçons de cette expérience (…)
Deux types de protection et de reconnaissance touchent la maison. Au niveau provincial, elle est classée immeuble patrimonial par le ministère de la Culture et des Communications. La protection s’applique également au terrain et au jardin, ainsi qu’aux biens meubles à l’intérieur. La résidence est aussi désignée lieu historique national du Canada par le gouvernement fédéral (…) la maison connaît alors de grandes rénovations, notamment pour réhabiliter son intérieur. Une maison demande toujours de l’entretien. D’autres chantiers ont ainsi été réalisés au cours des années. Ces rénovations nous ont permis de constater les défis qui entourent de tels chantiers, à savoir les enjeux financiers, mais aussi les difficultés liées à la recherche d’une main-d’œuvre qualifiée (…)
Les protections et reconnaissances de la maison peuvent, pour certains, sembler restrictives. Ces protections donnent cependant droit à de l’aide financière pour la restauration. Au niveau provincial, il existe le Volet I — restauration de biens patrimoniaux du programme Aide aux immobilisations et au fédéral, le Programme national de partage des frais pour les lieux patrimoniaux de Parcs Canada. Pour les propriétaires dont l’immeuble n’est pas désigné ou classé, d’autres moyens sont disponibles. Quelques municipalités offrent des programmes de soutien à certains travaux de rénovation ou de restauration, comme la Ville de Québec avec son Programme d’intervention et de revitalisation des bâtiments patrimoniaux. Elles sont toutefois encore trop peu nombreuses. Cela sans parler de l’absence de crédit d’impôt réservé à la rénovation et à la restauration de maisons patrimoniales. Quel que soit le palier de gouvernement de nouvelles mesures fiscales apporteraient une bouffée d’air non négligeable aux propriétaires vertueux et en inciteraient certainement d’autres à faire plus d’efforts pour préserver leurs biens.
Entretenir de façon adéquate une maison ancestrale demande évidemment d’effectuer un suivi régulier, mais aussi de faire appel à des spécialistes au savoir-faire rare, parfois unique (…) De nombreux chantiers et programmes de subventions exigent certains permis comme les cartes de la Régie du bâtiment du Québec, ce qui a souvent pour effet de limiter l’accès des artisans sur les chantiers.
La clé est certainement l’entretien quotidien de notre bâtiment et notre vigilance par rapport à son état général. Chaque intervention compte. Pour un propriétaire, il n’est pas toujours simple de faire une restauration complète. D’où l’importance de prévoir un échéancier. Il est plus facile d’effectuer de petits travaux au fur et à mesure que d’attendre et de devoir gérer de fortes dégradations nécessitant une intervention majeure. Pour l’entretien courant, il est crucial d’aller chercher l’information pertinente afin de s’assurer de prendre les bonnes décisions. Il existe des ressources en mesure d’accompagner les propriétaires dans leurs travaux. Les ressources en patrimoine de certaines municipalités peuvent également aiguiller les propriétaires vers les bonnes pratiques. À terme, il serait profitable d’instaurer au sein des municipalités ou des MRC un accompagnement systématique pour les propriétaires de maisons anciennes (…)
Occuper la maison Henry-Stuart avait un objectif double, soit celui de réinvestir un lieu résidentiel sans trop le dénaturer et de démontrer l’efficacité et les répercussions positives de la requalification des bâtiments. Outre les revenus de location, qui sont un bénéfice certain, des professionnels du patrimoine animent la maison au quotidien. Cela permet un suivi régulier de l’entretien et le maintien d’une maison au charme apprécié. Tout comme les églises ne peuvent pas toutes devenir des bibliothèques, les maisons anciennes ne peuvent pas toutes devenir des musées ou des bureaux. La requalification harmonieuse de bâtiments doit se faire selon plusieurs critères, en fonction notamment de l’environnement du quartier et des besoins de la communauté, mais également des ressources financières disponibles. En ce sens, la requalification de la maison Henry-Stuart est un exemple intéressant puisqu’elle intègre un usage contemporain en accueillant des bureaux et rend accessibles son intérieur unique et l’entièreté du site.
Les maisons anciennes font partie de notre patrimoine collectif, de notre histoire et de notre identité. Les rendre accessibles permet de développer un sentiment d’appartenance qui favorise la sensibilisation à ce patrimoine et sa préservation [2] ».
La démolition de plusieurs immeubles patrimoniaux a attiré l’attention du public québécois. La gestion déficiente de notre patrimoine a entraîné une sorte de prise de conscience collective. Comment expliquer la démolition de bâtiments si distinctifs, si beaux ? Que pourrait-on changer à notre manière de gérer le patrimoine ? Comment peut-on laisser des propriétaires agir négligemment sans qu’ils en subissent de conséquences ? Pourquoi les municipalités n’interviennent-elles pas ? Pourquoi des immeubles classés ou cités peuvent passer sous le pic des démolisseurs ? Sujet complexe, il va s’en dire. Un élément ressort néanmoins : il s’agit d’une mission partagée entre plusieurs intervenants et il est primordial de connaître le rôle de tous et chacun. De nombreux acteurs gravitent autour du patrimoine bâti : les propriétaires, les organismes locaux, le historiens, les urbanistes, les organismes nationaux, les villes, les municipalités régionales de comté (MRC), le gouvernement du Québec, le gouvernement fédéral, les mécènes, le public, etc. C’est en considérant chacun d’eux qu’il est possible d’avoir une vue d’ensemble de la gestion de notre patrimoine. AP a aussi répondu à ces questions et à ce contexte particulier.
« Au quotidien, le rôle de première ligne revient aux propriétaires qui vivent dans leur bâtiment. Le bon entretien de leur bien est souvent une priorité, mais il représente également une charge financière considérable qui peut s’avérer difficile à assumer. Malgré leur attachement à leur milieu de vie, ils doivent parfois privilégier l’aspect financier, au détriment de la préservation du patrimoine. En dépit des demandes répétées du milieu, aucun incitatif fiscal n’a encore été mis en place pour les aider.
Des organismes locaux sont là pour appuyer et guider les propriétaires, mais avant tout pour la sauvegarde du patrimoine. À cet égard, une grande responsabilité repose sur eux, surtout considérant qu’ils ont des moyens financiers limités. Certaines divergences d’opinions peuvent apparaître entre propriétaires et organismes. La maison Busteed, en Gaspésie, fournit un bon exemple de discordance entre les points de vue d’un propriétaire et des organismes locaux. Elle met en lumière des particularités quant à la perception des notions mêmes de patrimoine et de mémoire dans les différentes communautés. Les organismes nationaux assurent une veille sur tout le territoire québécois et offrent, selon les cas, des activités de diffusion, de sensibilisation et de formation. Les attentes sont grandes envers ces petites structures qui ont, comme les organismes locaux, des ressources limitées.
Les municipalités, en tant qu’acteurs dans la gestion des infrastructures locales et la mise en application de la réglementation, ont également un rôle majeur à jouer. Le chapitre IV de la Loi sur le patrimoine culturel octroie aux municipalités le pouvoir d’identifier et de protéger le patrimoine. Force est de constater, toutefois, depuis la mise en application de cette loi, les lacunes relatives à ce pouvoir. Il n’est pas ici question de jeter le blâme sur les municipalités. Il s’agit plutôt de tenter de comprendre pourquoi elles ne sont pas plus nombreuses à se prévaloir de la citation pour protéger des bâtiments dont la valeur patrimoniale est jugée exceptionnelle ou, à l’opposé, pourquoi certaines protections ne suffisent pas à garantir la préservation et la mise en valeur du patrimoine. Pour répondre à ces questions, il faut considérer plusieurs facteurs, comme les ressources parfois limitées des municipalités, le manque de volonté politique, une méconnaissance du patrimoine ou encore la pression des entrepreneurs. En parallèle, il y a des municipalités qui réussissent bien dans ce domaine et nous aurions intérêt à diffuser et à analyser leurs actions pour comprendre leur succès.
Les MRC ont un rôle dans l’aménagement du territoire. Elles se veulent, notamment, un agent facilitateur pour la mise en commun de services. En vertu de la Loi sur le patrimoine culturel, elles peuvent réaliser des inventaires du patrimoine bâti, ce qui permet d’avoir une vue d’ensemble du patrimoine d’un territoire. Par contre, les pouvoirs relatifs à la protection d’un immeuble patrimonial, dont la citation, reviennent aux municipalités.
Enfin, le gouvernement québécois doit faire preuve d’exemplarité et de leadership dans la protection du patrimoine et ainsi exercer un rôle de premier plan. Pour ce faire, plusieurs ministères sont responsables du patrimoine, notamment le ministère des Transports, celui des Affaires municipales et de l’Habitation, celui de l’Environnement et évidemment, celui de la Culture et des Communications. Ce dernier a un rôle de sensibilisation et doit se doter d’une vision claire en matière de patrimoine. Le classement est un des outils dont il dispose pour assurer la protection du patrimoine bâti. Toutefois, nous constatons, entre autres avec le moulin du Petit-Sault à L’Isle-Verte, que même les bâtiments classés peuvent être en danger. En effet, dans cet exemple, une partie de cet ancien moulin à farine, construit en 1823 et pourtant classé depuis 1962, a dû être démolie. Encore une fois, le manque de ressources financières a une incidence directe sur l’efficacité avec laquelle le ministère peut jouer son rôle. À titre d’exemple, la Direction générale du patrimoine a vu ses effectifs amputés d’environ 80 % depuis les années 70 (…)
En plus des enjeux financiers décriés, nous assistons également à une déresponsabilisation de plus en plus montrée du doigt par les médias. Ainsi, bien que la responsabilité en patrimoine soit partagée, les différents acteurs ont tendance à se renvoyer la balle pour diverses raisons [3] ».
Les intervenants et les autorités doivent donc s’allier pour atteindre un objectif commun, soit celui de s’engager à protéger et valoriser le patrimoine bâti. Un travail collectif et synchronisé permettra de faire fonctionner un mécanisme efficace voué à respecter et pérenniser notre patrimoine. Conserver ces trésors inestimables doit devenir notre obsession. La fierté d’un peuple n’a pas de prix. C’est sans compter les groupes de citoyens qui devront faire preuve de vigilance et assumer un rôle de chien de garde. Sensibiliser la population sera aussi une autre solution à envisager.
« Afin de mieux comprendre ce qui peut mettre un bâtiment patrimonial en péril, examinons de plus près un cas, celui de l’ensemble conventuel des Moniales dominicaines de Berthierville. Depuis plusieurs années, la communauté religieuse tente de vendre l’ensemble conventuel. Vacant depuis sept ans, il trouve preneur à la condition que le bâtiment soit démoli. Le promoteur achète donc l’édifice et dépose une demande de permis de démolir. Puisque le bâtiment ne bénéficie d’aucune protection, la demande est acceptée. C’est précisément à ce moment que les acteurs du milieu s’emparent du dossier.
Bien que l’inventaire de la MRC de D’Autray octroie une valeur exceptionnelle à l’ensemble conventuel, qualifie son état physique d’excellent et recommande une interdiction de le démolir, ces éléments n’ont pas été considérés lors de la demande de permis de démolition. Pourquoi? Parce que le pouvoir décisionnel revient aux municipalités et que, malgré la reconnaissance publique de la valeur du bâtiment, les recommandations de l’inventaire de la MRC n’ont pas été suivies. Berthierville n’a pas jugé bon de mettre en place une réglementation. Devant l’urgence de la situation, la ministre de la Culture s’est emparée du dossier et a émis une ordonnance de 30 jours pour faire temporairement arrêter le projet. Depuis, la ministre a demandé un avis d’intention de classement au Conseil du patrimoine culturel du Québec. Dans cet exemple, la remise en question ne provient pas de l’octroi du permis qui, en soi, ne va à l’encontre d’aucun règlement. Elle résulte plutôt du manque de volonté des municipalités de se doter des outils réglementaires de préservation du patrimoine à leur disposition (citation, plan d’implantation et d’intégration architecturale [4]) ».
Malheureusement, le dossier de Berthierville n’est pas unique, il est loin d’être une exception. Les cas de figure varient, mais le résultat demeure trop souvent le même. Si chacun a un rôle à remplir, il arrive que des intérêts divergents entrent en conflit. À l’heure actuelle, beaucoup de responsabilités reposent sur les propriétaires et sur les fabriques (et les paroisses) quand il est question du patrimoine religieux. Les promoteurs immobiliers, dans un exercice de capitalisme sauvage, n’ont malheureusement pas le souci d’assurer la préservation d’un immeuble patrimonial. Ils jouent aux matamores en achetant des propriétés patrimoniales et en trouvant mille et une astuces pour les démolir et ériger leur projet de construction (souvent des immeubles à condos modernes sans grande qualité architecturale). Nous pouvons entre autres rappeler le sort réservé à l’église Saint-Coeur-de-Marie de Québec, édifice d’un charme fou, qui fût au centre d’un litige entre la ville et un promoteur. Nous connaissons tous la fin de l’histoire : l’église a été démolie.
Les autorités et les décideurs vont-ils un jour comprendre l’importance qu’a notre patrimoine, qu’il est porteur de nostalgie, de grandeur, de beauté, de fierté, de respect du passé ? La classe politique et les gouvernements ont le pouvoir de changer les choses : y allouer plus de temps et d’argent, être plus rigoureux, s’y intéresser, se renseigner (leur manque de culture historique est flagrant). Le rôle de l’État est primordial. Nous le savons tous : il s’ingère trop fréquemment dans nos vies, il nous materne, il nous prend par la main. Mais l’enjeu du patrimoine, qui doit être bipartisan, est trop crucial, il doit faire partie de ses priorités politiques.
Le patrimoine doit générer plus d’émotions. Il s’agit du moteur de notre identité. Mais comment une municipalité peut-elle intervenir sans déplaire à des promoteurs parfois très influents ? Le patrimoine est un outil de séduction et d’orgueil pour une nation, mais il peut également devenir une contrainte dans certains cas. Les autorités ont à concilier les intérêts financiers de la ville, l’aspect touristique, les besoins des citoyens et l’acceptabilité sociale. La revitalisation d’un quartier historique, l’aménagement d’un parc commémoratif ou la rénovation d’un immeuble patrimonial engendra inévitablement des mécontents. De tels projets réclament de la patience et un travail pédagogique, ce qui revient à l’idée de sensibiliser la population. Répétons le : vouloir préserver le patrimoine bâti du Québec n’est pas un caprice de nationalistes ni un luxe ; c’est vouloir conserver notre richesse collective, c’est honorer nos ancêtres, c’est se souvenir qu’il y avait une vie avant nous, c’est célébrer qui nous sommes, c’est à la base de l’humanité.
Nous devons réfléchir à l’impact négatif de la disparition d’une maison, d’une église ou de tout autre emblème patrimonial, sur un village, une municipalité, une région, ou pour l’ensemble des Québécois, et aussi aux répercussions positives que peuvent amener le patrimoine bâti et le patrimoine immatériel. Au-delà des dollars, c’est une question de gros bon sens, de volonté politique, de vision, de passion, d’amour des siens. Pour paraphraser Lévesque, prendre soin de notre patrimoine, c’est « un beau risque ».
Une ville pas comme les autres : Québec
Je vis à Québec depuis toujours. Notre ville n’a rien à envier au monde entier. En fait, cette affirmation mérite des nuances. Je suis allé récemment à Boston, une ville que l’on compare à Québec pour son charme, son histoire, sa tranquillité, son patrimoine. Boston ressemble d’abord aux autres métropoles des États-Unis : sa richesse côtoie une grande pauvreté, la beauté rejoint la laideur, il y a l’odeur typique des grandes villes états-uniennes, la congestion routière, le paysage urbain qui comprend de nombreux gratte-ciels, le cosmopolitisme est partout, beaucoup de rues sont sales. Québec le vit également mais à un degré plus modeste. Nous avons pas la même réalité sociale ni le même regard sur la vie en générale. Mais une chose frappe toujours l’imaginaire lorsque je me rends aux États-Unis : leur fierté. Boston ne fait pas exception : la ville apporte un soin méticuleux à ses emblèmes, à ses drapeaux, à ses vieux édifices, à ses lieux historiques, à la valorisation des personnages qui ont marqué l’histoire de la ville et du pays. Les divers lieux de culte, les maisons anciennes et les bâtiments publics y sont admirablement préservés. La ville a aussi connu ses défis patrimoniaux, ses controverses, ses échecs, ses disputes, mais elle a réussi haut la main à conserver son cachet particulier. C’est utopique d’espérer, peu importe la ville, à une note parfaite, mais tout de même, Boston a su garder le cap.
Il n’est pas dit non plus que Québec n’emploi aucun effort patrimonial ; la ville tente de gérer, avec les moyens du bord, un défi colossal. Mais on peut comparer : l’attention portée par les Bostonnais et plus généralement par les états-uniens pour leur histoire ne peut nous servir que de leçon et à conscientiser nos décideurs. L’amour du patrimoine passe aussi par l’édification de monuments et de statues en hommage aux bâtisseurs. Ces œuvres d’art sont des tableaux à ciel ouvert, des hymnes à la grandeur d’une nation.
L’insensibilité des Québécois vis-à-vis leur histoire et leur patrimoine est sans doute temporaire. Nous en sommes encore à respirer le souffle d’une révolution tranquille qui a fait naître en nous un goût de renouveau, de modernité et qui surtout menée à une laïcité extrême qui a emporté notre passé catholique qui est maintenant à proscrire. Le ravage idéologique perpétré par les mondialistes y est pour quelque chose, mais le malaise est plus profond, plus complexe. Le Québec a besoin de leaders, d’un « capitaine patrimoine » et AP l’a bien démontré : les autorités doivent prendre leurs responsabilités. Mais à l’heure actuelle, l’enjeu du patrimoine est mal compris, mal étudié et très sous-estimé. Les politiciens, je le concède, ont souvent d’autres chats à fouetter, d’autres dossiers plus urgents. Les villes doivent s’occuper par exemples du réseau d’aqueduc, du déneigement, des vidanges, du transport en commun, du service d’incendie, de la sécurité, des services de proximité, etc. Elles ne sont pas non plus à l’abri de conflits de travail, de catastrophes naturelles, des évènements internationaux, des directives des autres instances gouvernementales. Les citoyens s’attendent à ce que leurs élus répondent à leurs besoins immédiats. Le gouvernement québécois a, devant lui, des enjeux nationaux difficiles à esquiver : la santé, les aînés, les infrastructures, l’éducation, la justice, la loi et l’ordre. Les politiciens à la François Legault ont pris la mauvaise habitude de gérer à la petite semaine, sur le court terme…et par électoralisme.
Le dossier du patrimoine oblige une vision à plus long terme et non pas une gestion sur un bout de papier. Intervient donc ici l’agenda politique. Un gouvernement peut avoir comme grands desseins de construire un barrage hydroélectrique, de créer des places en garderie, d’établir un réseau de transport en commun structurant, de mettre en place des politiques publiques ciblées pour tel ou tel sujet. Pourquoi ne pas avoir aussi un programme nationaliste et terre à terre qui mènerait à une remise en question du modèle québécois (trop socialiste et trop inefficace), à ajouter des mesures musclées pour protéger la langue française, à abaisser les seuils d’immigration et à avoir une vision globale et un plan détaillé concernant le patrimoine : alléger la bureaucratie, démêler le fouillis administratif, se donner des cibles, simplifier les démarches des propriétaires de maisons patrimoniales, serrer la vis aux promoteurs immobiliers trop gourmands. Une ville comme Québec peut et doit avoir une vision patrimoniale à 360 degrés : identifier les cas les plus problématiques, intervenir rapidement lorsqu’un bâtiment patrimonial est en danger, trouver des solutions créatives, regrouper les intervenants, accompagner les propriétaires dans leurs projets de rénovations et de mise en valeur. Le gouvernement du Québec et la ville de Québec ont les moyens financiers nécessaires pour dessiner un plan de match patrimonial crédible, étoffé, assumé et rigoureux.
Il faut, dans tous les cas, des politiciens solides, de bonne foi, qui se soucient sincèrement du sort de la nation. Des politiciens qui agissent dans un contexte de continuité historique. Le patrimoine, pour une ville comme Québec, devrait être un automatisme, un travail à temps plein ; la ville n’est-elle pas reconnue pour son charme et ses attraits touristiques ? Mais Québec regarde aussi à l’intérieur d’une lunette mondialiste qui favorise le modernisme banal et terne. Les politiciens sont des calculateurs, des carriéristes qui, pour se faire élire ou réélire, doivent prendre le pouls des citoyens : si ces derniers se rassemblent derrière la défense du patrimoine ou si les acteurs importants de la ville y travaillent (entreprises privées, médias, organismes, groupes de citoyens), la classe politique n’aura d’autre choix que d’écouter et d’agir. Pour que le patrimoine génère un tel enthousiasme, il faut d’abord reprendre le flambeau patriotique, être fier de qui nous sommes, redécouvrir notre histoire, retomber en amour avec nos racines.
Certains politiciens se passionnent pour le patrimoine. Certains sont aussi de vrais nationalistes. Mais ils ne sont pas assez nombreux – et un nationaliste peut sous-estimer l’importance de notre patrimoine dans sa lutte politique. L’indépendance du Québec passe par la question identitaire et nulle part ailleurs. Le patrimoine est un élément identitaire majeur. Les mondialistes mettront cependant les bouchées doubles pour ralentir le mouvement nationaliste. Ils aspirent à un État mondial et non pas aux États-nations. Le patrimoine a donc devant lui des adversaires coriaces : les mondialistes, la méconnaissance et l’indifférence.
AP a aussi longuement parlé d’un cadre réglementaire flou et mal ficelé et de nouvelles mesures financières à débloquer. Le propriétaire d’une maison ancienne ou d’un bâtiment historique a besoin de l’appui des gouvernements et non pas d’avoir des bâtons dans les roues. Une révision de la fiscalité québécoise jumelée à quelques incitatifs financiers auraient déjà, pour tout propriétaire, une incidence non négligeable. Ce sont des mesures concrètes et facilement applicables. Les Québécois doivent simplement avoir plus d’argent dans leurs poches. Les politiciens ont des décisions à prendre.
Les résidents de Québec aiment leur ville. Pourquoi tant de gens décident de venir s’y installer ? Pourquoi le tourisme se porte si bien? Est-ce pour apprécier sa plus récente tour à condos ? Pour s’émerveiller devant un nouveau quartier résidentiel ? Pour admirer son étalement urbain ? Bien sûr que non! C’est pour sa beauté, son architecture d’une autre époque, son histoire française et catholique, sa richesse patrimoniale. Chaque démolition ou disparition d’un morceau de notre patrimoine laisse un trou béant dans le visage urbain. Il faut savoir prendre du recul et apprécier ce que nous avons. Un immeuble patrimonial qui a perdu sa vocation première peut et doit avoir une deuxième vie : une église transformée en musée ou en bibliothèque représente l’apothéose de la reconversion réussie. Le Morrin Center, la Maison de la littérature et la Bibliothèque Claire-Martin le démontrent assurément.
La démolition de l’église Ste-cœur-de-Marie et les problèmes rencontrés par l’église du Très-St-Sacrement et l’église St-Jean-Baptiste, en plein cœur de Québec, ont révélé des lacunes évidentes dans la gestion de notre patrimoine. Ce sont des exemples à ne pas suivre. Ces églises centenaires ont été lâchement abandonnées. Les autorités ont laissé certains propriétaires insoucieux agirent à leur tête – ces derniers se sont arrangés pour que l’église se détériore au point de menacer de s’écrouler et de blesser les passants ; la démolition devenait alors la seule alternative possible. Une verrue urbaine maintenue artificiellement pendant des années par des promoteurs qui se moquent du cachet historique de la ville.
La voie à suivre est sans doute celle de la reconversion des églises abandonnées en bibliothèques ou en lieux culturels : c’est jumeler l’histoire et la culture. Ou pourquoi pas en musées nationaux, c’est-à-dire la version québécoise des bibliothèques présidentielles états-uniennes ou en musées racontant l’histoire de nos plus grand auteurs, de nos plus grands poètes, de nos plus grand musiciens et artistes ? Ou par la création d’un panthéon des sports du Québec qui viendrait célébrer l’histoire sportive du Québec. Il y a tellement d’options sur la table. Il suffit de rêver et de s’inspirer de ce qui se fait de meilleurs ailleurs.
Contrairement aux villages québécois où l’église et le presbytère sont devenus avec le temps leurs joyaux, leur identité, leurs pierres d’assises, le centre même de leurs activités culturelles et sociales, les grandes villes comme Montréal et Québec minimalisent voire banalisent la portée d’une démolition d’église. D’abord parce qu’elles comptent déjà des dizaines d’églises – donc à quoi bon s’affoler pour une de moins ? Et le Montréal multiethnique de Valérie Plante ne pleurera pas devant le triste sort d’une église. La laïcité a aussi implanté un mouvement « anticatholicisme ». N’est-il pas possible d’être athée ou embarrassé par les scandales du catholicisme sans pour autant renier notre patrimoine religieux ? Préserver notre héritage catholique n’a rien à voir avec la pratique religieuse elle-même, qui est peut être démodée, mais avec l’attachement que nous portons pour le beau, pour notre histoire, pour nos racines. En roulant à travers le Québec et en approchant d’un petit village, l’église et son presbytère illuminent le paysage. C’est ce que je remarque en premier. Le cœur villageois nous élève vers le ciel. Il est un marqueur du temps.
Sans réaction politique imminente ni de sentiment d’urgence, notre patrimoine s’effritera encore. Nous avons tous ont un rôle à jouer. Le patrimoine rend une ville plus belle, plus attrayante, plus fière, plus conviviable. Le Québec a des atouts : il est le berceau de l’Amérique française, il a été témoin de tant d’événements, son paysage nous charme depuis toujours, sa population est accueillante, il a une longue histoire à raconter. Célébrons notre passé. Notre patrimoine le mérite.