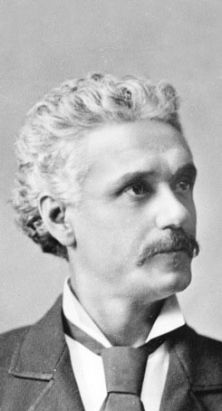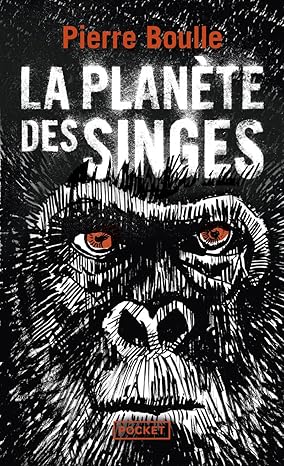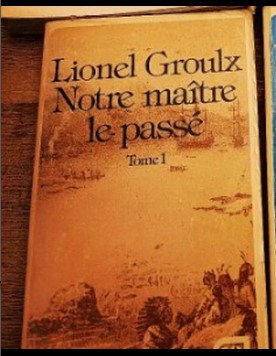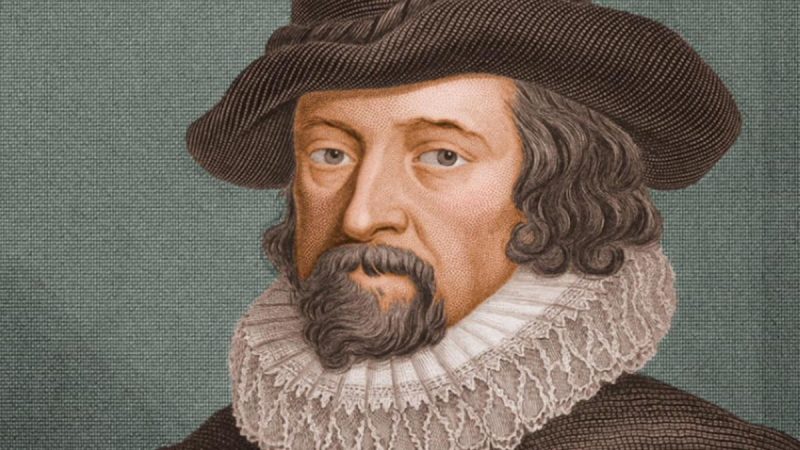Il y a eu un autre remaniement ministériel jeudi dernier à Québec. En effet, à mi-mandat, le Premier ministre du Québec Philippe Couillard a brassé ses cartes, dans un exercice purement esthétique et probablement électoraliste. Ce remue-ménage montre à nouveau le rôle parfois caricatural voire symbolique d’un ministre. La grande majorité des ministres sont interchangeables et n’opposent qu’une résistance minimale à la fonction publique puisqu’ils ne sont en poste qu’un bref moment : aussitôt qu’un ministre commence à maîtriser ses dossiers, il est nommé ailleurs, il est tout simplement dégommé ou part en campagne électorale. C’est la joute politique.
Le pouvoir réel n’est qu’entre les mains du Premier ministre, de quelques conseillers (sa garde rapprochée bien souvent non élue) et des apparatchiks du parti. Outre les ministres proches du Premier ministre, les ministres forts et ceux profitant d’une rare stabilité à leur ministère, ils ne deviennent, par la force des choses, que des coupeurs de rubans et des spécialistes en relations publiques. Par contre, notre régime parlementaire de type britannique (responsabilité ministérielle) fait bien souvent du ministre le seul responsable d’un scandale ou d’une crise quelconque à l’intérieur de son ministère – presque jamais la haute fonction publique ne sera blâmée.
Les jeux de chaise musicale, et tout particulièrement ceux en éducation, empêchent tout ministre de prendre du leadership et de l’assurance dans son nouveau rôle. Il y a bien eu au fil du temps des ministres exceptionnels, avant-gardistes ou bien en selle, comme peut l’être aujourd’hui le Dr. Gaétan Barrette, mais les dernières années nous auront montré des ministres sans envergure, des carriéristes, des partisans qui sont nommés dans un poste sans avoir nécessairement les compétences requises. Aux noms de la parité homme-femme, des stratégies politiques, des retours d’ascenseur, de l’équilibre régional ou générationnel, du copinage, le Premier ministre a le dernier mot. C’est sans passer sous silence le nombre élevé de nominations partisanes.
À cette époque aseptisée où la rectitude politique devient la norme et où l’image sur les médias sociaux est incontournable, le ministre a peu de marges de manœuvre : il se voit imposer une ligne de parti et il agit non pas comme tribun populaire ou un patriote travaillant à améliorer le sort réservé à la population mais comme un porte-parole, comme le simple membre d’une équipe ministérielle tissée serrée.
Les ministres nouvellement nommés débordent d’enthousiasme et se disent prêts à changer le monde et à changer les mentalités. Une fois ces belles paroles dites et la lune de miel terminée, l’esprit partisan reprendra ses droits et l’exercice du réel provoquera des désillusions permanentes.